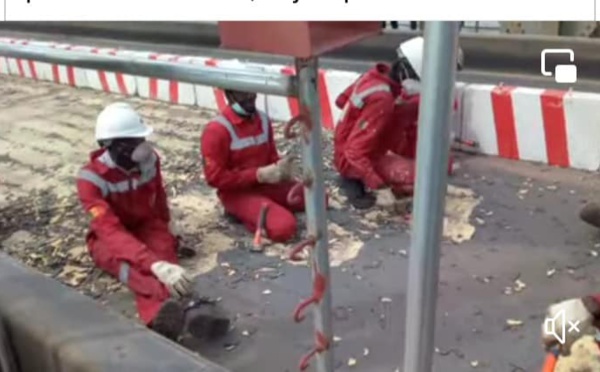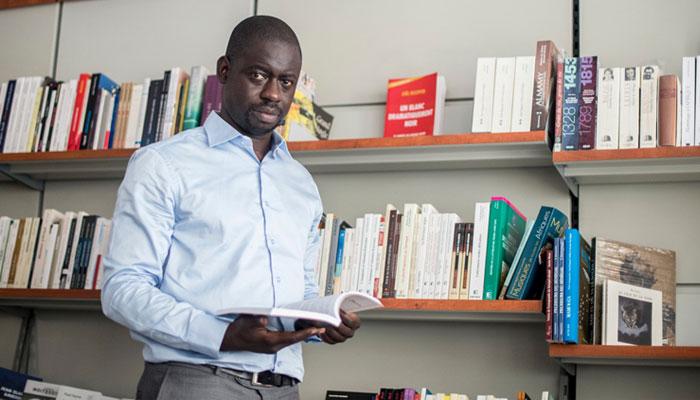
La crise du Covid-19 a fini de mettre à nu les failles du système économique néolibéral. Cela fait déjà quelques décennies que sa soutenabilité est remise en cause par maints travaux scientifiques depuis les rapports Meadows (1972) et Brundtland (1987). L’économie-monde, telle qu’elle se déploie et fonctionne est une économie de l’entropie qui carbonise le vivant et dont l’empreinte écologique est forte et négative. Elle rejette dans la biosphère plus de déchets que celle-ci ne peut absorber. Pour produire des biens et services à moindre coût, elle délocalise la production industrielle là où les facteurs de production sont les moins coûteux et crée des chaînes de valeurs internationales à circuit long.
La crise que nous vivons a montré les limites d’une telle organisation de la production. Pour se nourrir, une majorité de nations dépendent d’une production agricole réalisée à des milliers de kilomètres de chez elle, dont le transport accroit les émissions de gaz à effets de serre et accélère la réduction de la biodiversité. Cette interdépendance accrue permet d’avoir à sa table tous les produits du monde, mais constitue une vulnérabilité lorsque le commerce international est empêché par une raison qui limite la disponibilité des produits agricoles sur nos marchés (pandémie, guerre, fermeture commerciale, sanctions économiques, …). Il sera nécessaire dans ce domaine, sans prôner l’autarcie, de travailler à une sécurité et une souveraineté alimentaires.
Etre capable de répondre à ses besoins en nourriture dans un territoire, en produisant localement ce qui est nécessaire, en diversifiant ses sources d’approvisionnement et en retrouvant la fonction première de l’agriculture qui est de nourrir les humains. Par ailleurs, le type d’organisation des chaines de valeurs internationales conduit à une fragmentation du processus de production et à une hyper-concentration de ce dernier. La production de certains biens est presque exclusivement dévolue à quelques entreprises dans quelques pays. La pénurie de masques au début de la pandémie du Covid-19 a parfaitement illustré les limites d’une telle configuration.
Au début de la pandémie, les USA, la première économie du monde était au plein-emploi (3.5 % de chômage). En mai 2020, elle atteignait son niveau de chômage le plus élevé depuis la crise de 1929 (16,3%)[1] avec 20,5 millions d’emplois détruits sur une population active de 156 millions d’individus. Il est apparu que l’organisation, la conception et les modalités du travail de notre système économique induisent une précarisation généralisée des emplois dans la plupart des secteurs de la vie économique, et pas seulement de ceux relevant de l’économie dite informelle, dont la volatilité des revenus et l’absence de filets sociaux de ses travailleurs ont été rendu plus manifeste par la crise actuelle. Aussi bien dans l’aéronautique[2], la production de biens et services, que pour les secteurs du tourisme, de la culture, de la restauration, c’est une économie structurée autour d’une temporalité de court terme où la vie économique est financée par des recettes journalières, qui s’est révélée.
Une telle économie a besoin d’une accumulation quotidienne et à la petite semaine de cash-flows pour faire face aux charges d’exploitation dues mensuellement et aux traites bancaires, surtout pour les PME. Les grandes firmes qui ont des lignes de crédit ouvertes dans les banques, financent une grande partie de leur activité par endettement. Lorsqu’elles anticipent une baisse de l’activité dans les mois à venir, elles licencient. L’investissement et donc l’activité présente sont fortement liés à l’anticipation du futur. L’endettement étant un transfert des ressources du futur vers le présent, l’économie d’aujourd’hui est financée par les ressources de demain. Le système a une forte préférence pour le présent dont elle surpondère la valeur. Une telle économie vit au-dessus de ses moyens et entretient l’illusion de ses capacités et de sa puissance.
Lorsque le futur devient incertain, celui-ci par rétroaction affecte le temps présent dont le niveau d’activité et de consommation dépendent. Nous faisons l’expérience d’une économie qui pour produire des biens de consommation, souvent en excès, épuise la bio-capacité de la planète, surexploite ses ressources, entrave sa capacité à se régénérer et transfère des revenus futurs dans un temps présent. C’est une économie du présentisme, de la démesure, de la précarité généralisée et de l’étouffement. La repenser dans ses fondements structurels, ses modes de fonctionnements et ses finalités est vital pour la survie de nos sociétés.
Parmi les questions qu’elle soulève, figure celle de la rémunération du travail et de sa valeur. Les infirmières, les médecins, les caissières de supermarchés, les conducteurs d’autobus, tous les emplois liés aux soins ont révélé durant cette crise leur caractère essentiel pour la vie de nos sociétés, alors qu’ils sont les métiers les moins bien rémunérés par le système économique actuel, qui surpaye le capital, les intermédiaires, les bullshits jobs[3], les emplois des marchés captifs et sous-payent ceux qui contribuent à nourrir, à pérenniser et à soigner la vie[4]. Une réévaluation de la valeur marchande du travail et de sa rémunération pourrait être fondée sur sa contribution au maintien de la vie, à la préservation d’un environnement sain, à l’intelligence collective, à la production de savoirs et à la culture de l’esprit.
L’économie-monde est productrice d’inégalités entre les nations et à l’intérieur de celles-ci. Ces fractures sont apparues à plusieurs niveaux ; dans la faculté inégalitairement distribuée de disposer d’une épargne ou d’actifs qui permettent de traverser des moments difficiles, dans la possibilité d’accéder à des soins de qualité, mais également dans la différence de vulnérabilité des groupes humains selon l’historique des fragilités déjà constituées, notamment les comorbidités issues des conditions de vie difficiles. Ces inégalités sont liées au système de production de la valeur ajoutée de l’économie-monde et à ses modes de redistribution, aux règles du commerce international et à la division internationale du travail. Le système économique mondial est structurellement construit pour produire de l’inégalité et accélère l’entropie du vivant. C’est cette architecture qu’il faudra désarticuler, refonder les institutions qui la sous-tendent, repenser leurs missions (OMC, Institutions multilatérales, …) et inventer de nouveaux processus de régulation des relations macro et microéconomiques ; déconcentrer les pouvoirs et défaire les monopoles. Nous vivons dans un monde où un seul individu détient une richesse supérieure au PIB de 179 pays cumulés[5], ce qui représente 3,4 milliards d’individus et 43, 7 % de l’humanité. Voici l’étendue de la folie. Elle se passe de commentaires. Nous pourrions produire des règles qui plafonnent les richesses détenues par les individus, parce qu’à partir d’un certain seuil, une minorité pathologiquement accumulatrice, prive une majorité de ressources nécessaires à une vie digne ou limite ses possibilités d’y accéder.
La division internationale du travail a fait des nations émergentes et celles dites en développement des productrices de matières premières qui sont transformés dans des industries des pays du Nord. La valeur ajoutée est ainsi transférée des pays du Sud du Globe vers ceux dits du Nord. La convention est de mesurer la richesse produite en sommant les valeurs ajoutées produites annuellement. Ce concept de croissance du PIB ne prend pas en compte les coûts environnementaux, humains et sociaux de l’appareil productif mondial. Ici se pose la question de l’évaluation de la valeur de ce qui est produit, de son utilité et de son coût. En réalité nous sommes dans des économies de la mal-croissance, fondées sur un faux système comptable qui omet de comptabiliser ses vrais coûts et nomme inadéquatement ses actifs et ses passifs. Le prix de nos produits devrait intégrer leur coût environnemental et refléter leur contenu en carbone. Ce que nous appelons croissance économique, fait décroitre le vivant. Le système économique actuel en favorise l’entropie. Nous surpayons une production d’objets dont certains sont superflus et futiles, et ne servent qu’à entretenir des industries à un coût exorbitant pour la planète.
Une économie du vivant serait fondée sur une réévaluation de l’utilité de tous les secteurs de la vie économique au regard de leur contribution à la santé, au soin, au bien-être, à la préservation du vivant et à la pérennisation de la vie, à la cohésion sociale. C’est ce que Isabelle Delanauy appelle une économie symbiotique, cest-à-dire une économie dont le métabolisme n’affecte pas négativement les ordres sociaux, environnementaux et relationnels. L’une des questions épineuses des Etats durant la crise du Covid-19 a été de réaliser le bon arbitrage entre une reprise de la vie économique nécessaire pour répondre à nos besoins, et la préservation de la santé. Les deux étant liés dans une boucle récursive. Pour déconfiner, il a fallu commencer par faire redémarrer les activités jugées essentielles à la vie sociale. Il ne s’agit pas ici de prôner une limitation de la vie économique à la satisfaction des besoins biologiques fondamentaux : se nourrir, se soigner, se vêtir. Les besoins de l’esprit et de la culture sont aussi fondamentaux à nos sociétés, mais de se poser la question de l’utilité et de la nécessité des biens produits, de leur mode de production et de leurs impacts sociaux et environnementaux. On ne pourra plus se payer le luxe de ne pas interroger la finalité de la vie économique ainsi que ses modes de production ; ni de l’inscrire dans une cosmopolitique du vivant.
Une économie des communs
Dans une époque caractérisée par une crise écologique et un creusement des disparités économiques et sociales à l’échelle du globe, la nécessité de produire des communs et de préserver des espaces non-rivaux et non-exclusifs, garantissant un droit d’usage et d’accès au plus grand nombre aux ressources communes est impérieuse. La biodiversité, l’eau, l’air, les orbites géostationnaires, les quais de pêche, les droits humains sont autant de communs dont les règles de gestion doivent être co-définies par les parties prenantes. Le commun doit être constitué et une question importante est celle de sa fabrique et de sa gestion.
Les communs, avant de relever de discours sont d’abord des pratiques sociales du faire en commun. A chaque fois qu’une communauté décide de gérer une ressource collective en mettant l’accent sur l’accès équitable, la durabilité, l’inclusivité, un commun émerge. Elinor Ostrom s’est posée la question de savoir comment un groupe d'acteurs qui sont dans une situation d'interdépendance pouvait s’organiser et se gouverner pour préserver la continuité d'avantages communs ; lorsqu'ils sont tous confrontés à la tentation d'agir de façon opportuniste. Les constats empiriques indiquent que des communautés, principalement en milieu rural, peuvent gérer les ressources naturelles de manière durable et que les relations sociales jouent un rôle important à cet égard. Le commun au sens de Hardin est envisagé comme une ressource non gérée, n’appartenant à personne. La tendance des politiques fut de considérer l’acception du commun de Hardin. Cependant, dans la pratique, un commun, ne consiste pas seulement en une ressource, mais en un système social vivant d’agents créatifs, une communauté, qui gère ses ressources en élaborant ses propres règles, traditions et valeurs. Cette vision n’est pas prisée par les économistes car elle déplace le débat en dehors du cadre théorique de l’Homo economicus, en faisant appel aux autres sciences humaines et sociales comme l’anthropologie, la sociologie, la psychologie ; mais surtout, elle rend difficile l’élaboration de modèles quantitatifs rassurants. Dans la réalité, lorsqu’il y a un nombre élevé de facteurs idiosyncratiques locaux, historiques, culturels qui rendent difficile la proposition d’une norme universelle standard, ceci contrarie la tentation nomologique de l’économie qui veut transformer toute régularité statistique, en norme. Les communs nomment un ensemble de valeurs sociales qui se situent au-delà du prix du marché et de l’appropriation privative. Ils reflètent des réalités informelles, intergénérationnelles, expérientielles, écologiques, qui ne peuvent être comprises uniquement par la théorie de l'acteur rationnel ou les récits néo-darwiniens de l'économie néolibérale.
Pourquoi il est important d’élaborer un langage des communs ?
Le langage des communs permet de nommer et d’éclairer les réalités des enclosures du marché et la valeur du faire en commun. C’est un instrument de réorientation de la perception et de la compréhension. Sans un langage des communs, les réalités sociales auxquelles ils renvoient resteront invisibles ou culturellement marginalisées, donc politiquement sans conséquences. Aussi, le discours sur les communs est un geste épistémologique qui permet de réintégrer des valeurs sociales, écologiques et éthiques dans la gestion de notre richesse commune. Cette langue permet de formuler des revendications politiques et des hiérarchies de valeurs. Elle permet aussi de nous extraire des rôles sociaux étriqués dans lesquels nous sommes enfermés (consommateur, électeur, citoyen).
Nous sommes gouvernés par un ordre du discours. Une expertise internationale qui fait système. C’est un matériau à dimension multiples (théories économiques, accords commerciaux, littérature managériale mainstream) qui relève d’un mélange de registre théoriques et systémiques. Des langages qui à travers des discursivités hétérogènes se reconnaissent et se renforcent. C’est ce que Foucault appelle une archive. A notre époque, une théorie philosophique puissante n’a pas plus d’effet qu’un mot d’ordre. Nous sommes gouvernés par un langage qui fait système, Pour sortir de ce langage et de la réalité qu’il crée, il est nécessaire d’élaborer celui d’une économie du vivant et de la production de communs, préludes à l’élaboration de ses pratiques de son éthique et de ses finalités. Une économie du vivant nécessite une refonte complète de l’économie comme pratique et ordre du discours. Il s’agit de reconstruire la discipline, ses fondements, sa pratique, son axiologie, ses finalités et de les intégrer dans la plus haute des finalités : celle de nourrir la vie.
[1] Données du Bureau of Labor and Statistics, (BLS) USA
[2] Air Canada a licencié 70 % de ses salariés. Air France a eu besoin d’une injection de 7 milliards d’euros de la part de l’Etat Français et Néerlandais pour faire face aux effets de la crise. L’Etat Allemand est entré dans le capital de la Lufthansa avec un investissement de 3 milliards d’euros.
[3] Voir David Graeber, Bullshit Jobs (2018), éditions les Liens qui Libèrent.
[4] La France a décidé d’une revalorisation salariale des personnels soignants dont on s’est rendu compte de l’importance de la contribution dans la crise sanitaire
[5] M. Bezos, le patron de Amazon dont la fortune pourrait dépasser 1000 milliards de dollars en 2026, d’après le média américain Esquire.
La crise que nous vivons a montré les limites d’une telle organisation de la production. Pour se nourrir, une majorité de nations dépendent d’une production agricole réalisée à des milliers de kilomètres de chez elle, dont le transport accroit les émissions de gaz à effets de serre et accélère la réduction de la biodiversité. Cette interdépendance accrue permet d’avoir à sa table tous les produits du monde, mais constitue une vulnérabilité lorsque le commerce international est empêché par une raison qui limite la disponibilité des produits agricoles sur nos marchés (pandémie, guerre, fermeture commerciale, sanctions économiques, …). Il sera nécessaire dans ce domaine, sans prôner l’autarcie, de travailler à une sécurité et une souveraineté alimentaires.
Etre capable de répondre à ses besoins en nourriture dans un territoire, en produisant localement ce qui est nécessaire, en diversifiant ses sources d’approvisionnement et en retrouvant la fonction première de l’agriculture qui est de nourrir les humains. Par ailleurs, le type d’organisation des chaines de valeurs internationales conduit à une fragmentation du processus de production et à une hyper-concentration de ce dernier. La production de certains biens est presque exclusivement dévolue à quelques entreprises dans quelques pays. La pénurie de masques au début de la pandémie du Covid-19 a parfaitement illustré les limites d’une telle configuration.
Au début de la pandémie, les USA, la première économie du monde était au plein-emploi (3.5 % de chômage). En mai 2020, elle atteignait son niveau de chômage le plus élevé depuis la crise de 1929 (16,3%)[1] avec 20,5 millions d’emplois détruits sur une population active de 156 millions d’individus. Il est apparu que l’organisation, la conception et les modalités du travail de notre système économique induisent une précarisation généralisée des emplois dans la plupart des secteurs de la vie économique, et pas seulement de ceux relevant de l’économie dite informelle, dont la volatilité des revenus et l’absence de filets sociaux de ses travailleurs ont été rendu plus manifeste par la crise actuelle. Aussi bien dans l’aéronautique[2], la production de biens et services, que pour les secteurs du tourisme, de la culture, de la restauration, c’est une économie structurée autour d’une temporalité de court terme où la vie économique est financée par des recettes journalières, qui s’est révélée.
Une telle économie a besoin d’une accumulation quotidienne et à la petite semaine de cash-flows pour faire face aux charges d’exploitation dues mensuellement et aux traites bancaires, surtout pour les PME. Les grandes firmes qui ont des lignes de crédit ouvertes dans les banques, financent une grande partie de leur activité par endettement. Lorsqu’elles anticipent une baisse de l’activité dans les mois à venir, elles licencient. L’investissement et donc l’activité présente sont fortement liés à l’anticipation du futur. L’endettement étant un transfert des ressources du futur vers le présent, l’économie d’aujourd’hui est financée par les ressources de demain. Le système a une forte préférence pour le présent dont elle surpondère la valeur. Une telle économie vit au-dessus de ses moyens et entretient l’illusion de ses capacités et de sa puissance.
Lorsque le futur devient incertain, celui-ci par rétroaction affecte le temps présent dont le niveau d’activité et de consommation dépendent. Nous faisons l’expérience d’une économie qui pour produire des biens de consommation, souvent en excès, épuise la bio-capacité de la planète, surexploite ses ressources, entrave sa capacité à se régénérer et transfère des revenus futurs dans un temps présent. C’est une économie du présentisme, de la démesure, de la précarité généralisée et de l’étouffement. La repenser dans ses fondements structurels, ses modes de fonctionnements et ses finalités est vital pour la survie de nos sociétés.
Parmi les questions qu’elle soulève, figure celle de la rémunération du travail et de sa valeur. Les infirmières, les médecins, les caissières de supermarchés, les conducteurs d’autobus, tous les emplois liés aux soins ont révélé durant cette crise leur caractère essentiel pour la vie de nos sociétés, alors qu’ils sont les métiers les moins bien rémunérés par le système économique actuel, qui surpaye le capital, les intermédiaires, les bullshits jobs[3], les emplois des marchés captifs et sous-payent ceux qui contribuent à nourrir, à pérenniser et à soigner la vie[4]. Une réévaluation de la valeur marchande du travail et de sa rémunération pourrait être fondée sur sa contribution au maintien de la vie, à la préservation d’un environnement sain, à l’intelligence collective, à la production de savoirs et à la culture de l’esprit.
L’économie-monde est productrice d’inégalités entre les nations et à l’intérieur de celles-ci. Ces fractures sont apparues à plusieurs niveaux ; dans la faculté inégalitairement distribuée de disposer d’une épargne ou d’actifs qui permettent de traverser des moments difficiles, dans la possibilité d’accéder à des soins de qualité, mais également dans la différence de vulnérabilité des groupes humains selon l’historique des fragilités déjà constituées, notamment les comorbidités issues des conditions de vie difficiles. Ces inégalités sont liées au système de production de la valeur ajoutée de l’économie-monde et à ses modes de redistribution, aux règles du commerce international et à la division internationale du travail. Le système économique mondial est structurellement construit pour produire de l’inégalité et accélère l’entropie du vivant. C’est cette architecture qu’il faudra désarticuler, refonder les institutions qui la sous-tendent, repenser leurs missions (OMC, Institutions multilatérales, …) et inventer de nouveaux processus de régulation des relations macro et microéconomiques ; déconcentrer les pouvoirs et défaire les monopoles. Nous vivons dans un monde où un seul individu détient une richesse supérieure au PIB de 179 pays cumulés[5], ce qui représente 3,4 milliards d’individus et 43, 7 % de l’humanité. Voici l’étendue de la folie. Elle se passe de commentaires. Nous pourrions produire des règles qui plafonnent les richesses détenues par les individus, parce qu’à partir d’un certain seuil, une minorité pathologiquement accumulatrice, prive une majorité de ressources nécessaires à une vie digne ou limite ses possibilités d’y accéder.
La division internationale du travail a fait des nations émergentes et celles dites en développement des productrices de matières premières qui sont transformés dans des industries des pays du Nord. La valeur ajoutée est ainsi transférée des pays du Sud du Globe vers ceux dits du Nord. La convention est de mesurer la richesse produite en sommant les valeurs ajoutées produites annuellement. Ce concept de croissance du PIB ne prend pas en compte les coûts environnementaux, humains et sociaux de l’appareil productif mondial. Ici se pose la question de l’évaluation de la valeur de ce qui est produit, de son utilité et de son coût. En réalité nous sommes dans des économies de la mal-croissance, fondées sur un faux système comptable qui omet de comptabiliser ses vrais coûts et nomme inadéquatement ses actifs et ses passifs. Le prix de nos produits devrait intégrer leur coût environnemental et refléter leur contenu en carbone. Ce que nous appelons croissance économique, fait décroitre le vivant. Le système économique actuel en favorise l’entropie. Nous surpayons une production d’objets dont certains sont superflus et futiles, et ne servent qu’à entretenir des industries à un coût exorbitant pour la planète.
Une économie du vivant serait fondée sur une réévaluation de l’utilité de tous les secteurs de la vie économique au regard de leur contribution à la santé, au soin, au bien-être, à la préservation du vivant et à la pérennisation de la vie, à la cohésion sociale. C’est ce que Isabelle Delanauy appelle une économie symbiotique, cest-à-dire une économie dont le métabolisme n’affecte pas négativement les ordres sociaux, environnementaux et relationnels. L’une des questions épineuses des Etats durant la crise du Covid-19 a été de réaliser le bon arbitrage entre une reprise de la vie économique nécessaire pour répondre à nos besoins, et la préservation de la santé. Les deux étant liés dans une boucle récursive. Pour déconfiner, il a fallu commencer par faire redémarrer les activités jugées essentielles à la vie sociale. Il ne s’agit pas ici de prôner une limitation de la vie économique à la satisfaction des besoins biologiques fondamentaux : se nourrir, se soigner, se vêtir. Les besoins de l’esprit et de la culture sont aussi fondamentaux à nos sociétés, mais de se poser la question de l’utilité et de la nécessité des biens produits, de leur mode de production et de leurs impacts sociaux et environnementaux. On ne pourra plus se payer le luxe de ne pas interroger la finalité de la vie économique ainsi que ses modes de production ; ni de l’inscrire dans une cosmopolitique du vivant.
Une économie des communs
Dans une époque caractérisée par une crise écologique et un creusement des disparités économiques et sociales à l’échelle du globe, la nécessité de produire des communs et de préserver des espaces non-rivaux et non-exclusifs, garantissant un droit d’usage et d’accès au plus grand nombre aux ressources communes est impérieuse. La biodiversité, l’eau, l’air, les orbites géostationnaires, les quais de pêche, les droits humains sont autant de communs dont les règles de gestion doivent être co-définies par les parties prenantes. Le commun doit être constitué et une question importante est celle de sa fabrique et de sa gestion.
Les communs, avant de relever de discours sont d’abord des pratiques sociales du faire en commun. A chaque fois qu’une communauté décide de gérer une ressource collective en mettant l’accent sur l’accès équitable, la durabilité, l’inclusivité, un commun émerge. Elinor Ostrom s’est posée la question de savoir comment un groupe d'acteurs qui sont dans une situation d'interdépendance pouvait s’organiser et se gouverner pour préserver la continuité d'avantages communs ; lorsqu'ils sont tous confrontés à la tentation d'agir de façon opportuniste. Les constats empiriques indiquent que des communautés, principalement en milieu rural, peuvent gérer les ressources naturelles de manière durable et que les relations sociales jouent un rôle important à cet égard. Le commun au sens de Hardin est envisagé comme une ressource non gérée, n’appartenant à personne. La tendance des politiques fut de considérer l’acception du commun de Hardin. Cependant, dans la pratique, un commun, ne consiste pas seulement en une ressource, mais en un système social vivant d’agents créatifs, une communauté, qui gère ses ressources en élaborant ses propres règles, traditions et valeurs. Cette vision n’est pas prisée par les économistes car elle déplace le débat en dehors du cadre théorique de l’Homo economicus, en faisant appel aux autres sciences humaines et sociales comme l’anthropologie, la sociologie, la psychologie ; mais surtout, elle rend difficile l’élaboration de modèles quantitatifs rassurants. Dans la réalité, lorsqu’il y a un nombre élevé de facteurs idiosyncratiques locaux, historiques, culturels qui rendent difficile la proposition d’une norme universelle standard, ceci contrarie la tentation nomologique de l’économie qui veut transformer toute régularité statistique, en norme. Les communs nomment un ensemble de valeurs sociales qui se situent au-delà du prix du marché et de l’appropriation privative. Ils reflètent des réalités informelles, intergénérationnelles, expérientielles, écologiques, qui ne peuvent être comprises uniquement par la théorie de l'acteur rationnel ou les récits néo-darwiniens de l'économie néolibérale.
Pourquoi il est important d’élaborer un langage des communs ?
Le langage des communs permet de nommer et d’éclairer les réalités des enclosures du marché et la valeur du faire en commun. C’est un instrument de réorientation de la perception et de la compréhension. Sans un langage des communs, les réalités sociales auxquelles ils renvoient resteront invisibles ou culturellement marginalisées, donc politiquement sans conséquences. Aussi, le discours sur les communs est un geste épistémologique qui permet de réintégrer des valeurs sociales, écologiques et éthiques dans la gestion de notre richesse commune. Cette langue permet de formuler des revendications politiques et des hiérarchies de valeurs. Elle permet aussi de nous extraire des rôles sociaux étriqués dans lesquels nous sommes enfermés (consommateur, électeur, citoyen).
Nous sommes gouvernés par un ordre du discours. Une expertise internationale qui fait système. C’est un matériau à dimension multiples (théories économiques, accords commerciaux, littérature managériale mainstream) qui relève d’un mélange de registre théoriques et systémiques. Des langages qui à travers des discursivités hétérogènes se reconnaissent et se renforcent. C’est ce que Foucault appelle une archive. A notre époque, une théorie philosophique puissante n’a pas plus d’effet qu’un mot d’ordre. Nous sommes gouvernés par un langage qui fait système, Pour sortir de ce langage et de la réalité qu’il crée, il est nécessaire d’élaborer celui d’une économie du vivant et de la production de communs, préludes à l’élaboration de ses pratiques de son éthique et de ses finalités. Une économie du vivant nécessite une refonte complète de l’économie comme pratique et ordre du discours. Il s’agit de reconstruire la discipline, ses fondements, sa pratique, son axiologie, ses finalités et de les intégrer dans la plus haute des finalités : celle de nourrir la vie.
[1] Données du Bureau of Labor and Statistics, (BLS) USA
[2] Air Canada a licencié 70 % de ses salariés. Air France a eu besoin d’une injection de 7 milliards d’euros de la part de l’Etat Français et Néerlandais pour faire face aux effets de la crise. L’Etat Allemand est entré dans le capital de la Lufthansa avec un investissement de 3 milliards d’euros.
[3] Voir David Graeber, Bullshit Jobs (2018), éditions les Liens qui Libèrent.
[4] La France a décidé d’une revalorisation salariale des personnels soignants dont on s’est rendu compte de l’importance de la contribution dans la crise sanitaire
[5] M. Bezos, le patron de Amazon dont la fortune pourrait dépasser 1000 milliards de dollars en 2026, d’après le média américain Esquire.










 ACCUEIL
ACCUEIL