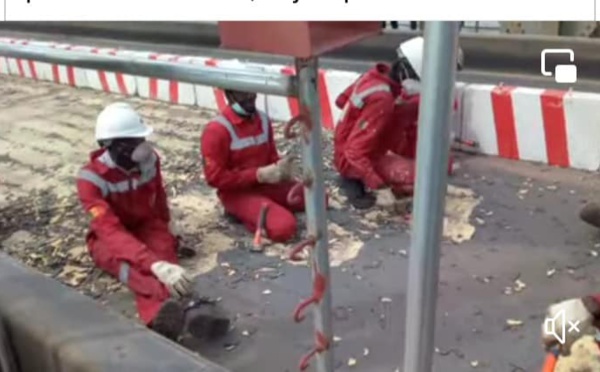Seulement voilà : la pandémie du Covid-19 renverse la table pour s’installer durablement. « Nous devrons vivre avec le virus », dira, dans une récente déclaration, le chef de l’Etat qui tente, en première ligne, de surmonter la crise sanitaire affectant le pays. Justement le « pays profond » est le plus atteint, le plus impacté au regard des chiffres qui traduisent éloquemment la virulence de l’infection. Les cas contacts et les cas communautaires y fleurissent faute d’un précoce repérage des foyers de propagation. Mais l’acuité de la pandémie ne devrait point occulter un autre sujet de préoccupation : la campagne agricole. Au même titre que la reprise des cours dans les écoles et des audiences publiques dans les Cours et Tribunaux.
Une réalité demeure cependant : notre agriculture occupe plus de 56 % de la population sénégalaise. Celle-ci vieillit. Le renouvellement s’opère autrement. Les jeunes ruraux fuient les travaux champêtres qu’ils jugent pénibles et peu valorisants. Ils viennent s’agglutiner en villes occupant des activités rudimentaires et très peu stimulantes. En sens inverse, des jeunes des cités et des banlieues, victimes du chômage, s’extirpent à leur tour des milieux urbains et vont à la découverte des campagnes.
Ce double mouvement traduit donc une instabilité de situation aggravée aujourd’hui par l’inertie et le manque de perspectives. Attardons-nous cependant sur certaines données : nous avons près de trois millions d’hectares de terres arables. Riches et fertiles, ces terres sont, aux deux-tiers, inexploitées alors qu’elles restent disponibles pour une variété de cultures, même spéculatives. L’autre facteur est d’ordre financier : des investissements massifs sont nécessaires pour changer la physionomie de l’agriculture sénégalaise dépendante des pluies et des intrants agricoles, notamment l’engrais et les pesticides.
Les précipitations sont de moins en moins au rendez-vous. Elles ont diminué en intensité et en volume. Il y a quinze ou vingt ans, la saison des pluies s’installait dès fin avril ou début mai. Maintenant, jusqu’au mois de juin le ciel n’ouvre pas ses vannes. A fin août déjà, la saison se clôt. Puis la saison sèche prend le relais à nouveau. En vérité, une courte saison hivernale (les moussons) qui pousse, par son effet répétitif, à des impératifs d’adaptation pour assurer la survie du monde paysan. D’où la mise sur les marchés de variétés hâtives, issues des centres de recherches tel que l’ISRA, susceptibles d’épouser les contraintes climatologiques.
Aux yeux de nombreux observateurs, le changement climatique, surtout le réchauffement, explique ces perturbations voire ces permutations auxquelles doivent s’habituer désormais les agriculteurs. Doués de sens et surtout de bon sens, ils appréhendent les phénomènes qui les environnent avec un réalisme teinté de sagesse. Ils savent ce qu’il convient de faire. Puisqu’ils sont sur le terrain et vivent les réalités de plus près.
Majoritaire du point de vue du recensement, le monde rural n’en est pas moins fragile. Un vrai paradoxe alors qu’il représente une force assoupie. Que gagne le pays en laissant les agriculteurs désunis et inorganisés ? Qui parle en leur nom alors pour défendre leurs intérêts ? L’immobilisme constaté des décennies durant est à l’origine de la paupérisation du monde rural très mal défendu dans les instances de décisions.
Touchés de plein fouet, les paysans n’ont plus de réserves et dépourvus de liquidités, ils voient leur quotidien s’assombrir. De tout temps d’ailleurs, ils n’ont cessé de prôner le maintien de l’agriculture vivrière, dite, par euphémisme, « agriculture familiale ». Elle est perçue comme vitale en période de crise puisqu’elle accroit la résilience des paysans face à des pénuries ou des rétentions. Ils sont nombreux, ingénieurs agricoles, politiques, décideurs et dirigeants d’instituts à valider la pertinence des périmètres domestiques.
La souveraineté alimentaire est à ce prix, estiment-ils. De même que la sûreté alimentaire qui en est le corollaire. Car, mieux vaut inciter les agriculteurs à produire ce qu’ils consomment plutôt que de les assujettir à des importations aléatoires. Une crise de la faim est vite arrivée. Qu’adviendrait-il si les pays producteurs de riz stoppaient les exportations de la céréale au motif que des risques de pénuries planent. Les gros pays producteurs d’Asie (Chine, Inde, Cambodge, Vietnam) ont accru leurs réserves stratégiques au point d’annuler les quantités destinées au marché international.
En clair, si les pays importateurs n’inversent pas les priorités (et à temps) la crainte d’une crise de la faim pourrait déferler en Afrique avec des conséquences incalculables. Selon la FAO, 11 % de la population mondiale souffre de faim. L’organisation, qui a son siège à Rome, redoute une extension de la vulnérabilité devant toucher désormais de nouvelles couches sociales jusque-là épargnées.
De plus en plus de voix s’élèvent pour prôner un renversement de perspective en rectifiant la trajectoire de l’agriculture sénégalaise et africaine. C’est maintenant qu’il faut emblaver davantage de terres pour s’adonner à la culture du riz. La vallée s’y prête. Avec quelque 240 mille hectares il est possible d’enrayer un éventuel déficit vivrier qui serait ressenti comme une atteinte à toute dignité. Une bourrasque sociale et économique, bien qu’imprévisible, ne devrait pas être écartée.
Evidemment, l‘inversion des priorités, dictée par cette crise sanitaire transforme une partie entière de notre politique agricole en château de carte ébranlé dans ses fondements. Une lucidité s’impose pour apprécier les conséquences de la crise comme une série d’opportunités devant remettre en selle l’agriculture. Il remet au goût du jour ses objectifs et sa finalité afin de réconcilier les Sénégalais avec la préférence nationale, sans chauvinisme toutefois.
Mamadou NDIAYE










 ACCUEIL
ACCUEIL