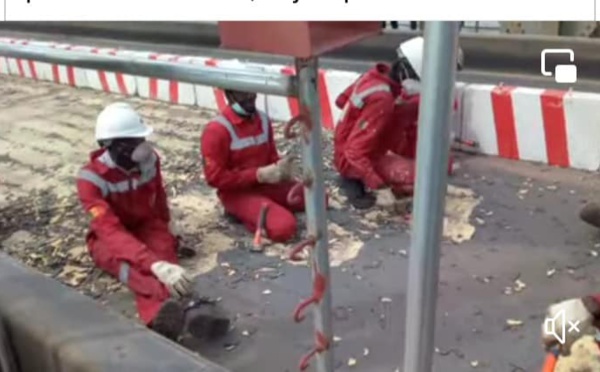Alors que l’humanité aborde le vingt-et-unième siècle avec des avancées technologiques jusqu’ici inégalées, l’Afrique, notre Afrique, en est encore à s’interroger sur son sort, menacée qu’elle est, chaque jour encore plus, d’être exclue du mouvement de mondialisation et de demeurer « l’Homme malade du globe ». Et, dans un tel contexte, il est plus que surprenant que notre continent soit aussi le moins enthousiaste pour engager les réformes indispensables pour converger avec les meilleurs et rattraper le temps perdu.
Certes, un frémissement a pu être noté récemment, avec des performances en termes de croissance supérieures à 5% par an en moyenne sur le continent. Mais, celles-ci demeurent encore insuffisantes pour propulser la grande majorité des pays africains sur la rampe de l’émergence.
Aujourd’hui ces pays peuvent être classés en quatre groupes :
➢ premier groupe : celui des pays dont les dirigeants ignorent qu’ils doivent mener le changement ou qui n’en sont pas convaincus pour des motifs idéologiques ou encore qui ne peuvent pas l’engager pour des raisons indépendantes de leur volonté (cas des pays qui connaissent des guerres civiles comme la Somalie). Avec la normalisation politique progressive, ce groupe a perdu beaucoup de ses adeptes. On intitulera ce groupe celui des « résistants-incapables de changement » ;
➢ deuxième groupe : celui des pays dont les dirigeants savent que le changement s’impose, qui peuvent le décréter mais qui préfèrent ne pas s’y embarquer, par peur de saper leur base populaire ou leurs privilèges.
Plusieurs pays à économie rentière, dirigés par des chefs d’Etat théocratiques, se retrouvent dans ce cas. Ne pouvant toujours résister aux pressions des partenaires au développement, ces dirigeants n’accordent qu’un soutien vague et limité aux réformes, les ajournent sans cesse et/ou ne les appliquent que de manière partielle et incomplète. Ce groupe pourrait s’appeler celui des «conservateurs-populistes»;
➢ troisième groupe : celui des pays qui croient sincèrement aux vertus du changement, mais qui ne savent pas le réussir, car ne s’étant aménagé au préalable ni les capacités ni les moyens pour transformer leurs rêves en réalités ; un nombre de plus en plus élevé de pays africains se retrouvent dans cette catégorie, avec des niveaux gradués de performances. Nous les appellerons les « réformistes-utopistes » ;
➢ enfin, le quatrième groupe, très réduit dans sa composition, des pays qui non seulement savent lire les lignes d’horizon et définir une vision, mais s’appliquent quotidiennement à atteindre le but fixé et à améliorer réellement leur situation, par la mise en œuvre effective d’une stratégie et d’un plan d’actions efficace et maîtrisé. Ce groupe est celui des « champions du changement ». On peut y compter l’Ile Maurice et le Rwanda.
Une question se pose à ce niveau. Où classer le Sénégal ? Certainement pas dans le premier groupe. S’il est en effet un point sur lequel toute la classe politique sénégalaise s’accorde, c’est la nécessité de changer le destin de notre pays, l’intégrer pleinement dans l’économie mondiale et offrir des perspectives plus reluisantes à ses filles et à ses fils.
Mais, au delà de la rhétorique, le changement doit se manifester dans les faits et aboutir à des résultats visibles et palpables. En jugeant les faits, et uniquement les faits, force est de constater que nous ne pouvons pas encore prétendre au groupe des « champions du changement » (le quatrième groupe). Si tel était le cas, les Sénégalais l’auraient ressenti dans leur vie quotidienne.
Or que nous disent les chiffres ? Selon les statistiques officielles (ANSD, comptes nationaux et recensement de la population en 2013), la croissance économique dépasse à peine 3% en moyenne depuis 2006, plus de deux Sénégalais sur cinq sont considérés comme pauvres, 20% des enfants ne fréquentent pas l’école primaire, 54% la population est analphabète, plus d’un Sénégalais sur quatre est au chômage (et beaucoup d’autres en situation de sous-emploi), 26,2% n’ont pas accès à une eau potable, 42,5% n’ont pas accès à l’électricité, le risque pour un enfant de décéder avant le premier anniversaire est de 53 pour mille, le taux mortalité maternelle est de 434 décès pour 100.000 naissances vivantes. Toutes ces données économiques et sociales constituent des contre-performances notables, même si des progrès sont constatés pour certains indicateurs.
Au mieux, nous ne pouvons donc nous comptabiliser que dans le troisième groupe (celui des « réformistes utopistes »). Et encore, dans certains domaines – en particulier, pour tout ce qui remet en cause des avantages acquis-, il y a, depuis bien longtemps, mise à part la période de la dévaluation pendant laquelle une politique courageuse a été mise en œuvre, comme une inertie qui fait perdurer le statu-quo et le consensus ante (attitude préférée des pays du deuxième groupe) au détriment du mouvement.
Ainsi nous manquons toujours de stratégie cohérente au niveau industriel, de programme pour transformer les paysans en acteurs dynamiques de l’émergence et insérer notre économie dans les échanges mondiaux. Au surplus, nous n’offrons ni accompagnement digne de ce nom à l’insertion professionnelle des diplômés, ni modèle de société aux jeunes, les laissant se débrouiller seuls pour rechercher un travail et se fixer eux-mêmes leurs propres valeurs.
Partout, nous préférons différer les réformes, s’attacher à l’accessoire plutôt qu’à l’essentiel, toucher la corde sensible du peuple plutôt que le pousser à être productif et compétitif. Et, tant que nous nous contenterons de solutions partielles et éviterons les sujets qui fâchent ou qui demandent des efforts difficiles sur la durée, nous continuerons, en dépit de nos innombrables atouts, de jouer dans la cour des pays pauvres et sans espoir.
Partout, nous préférons croire au miracle, nous dire inlassablement que nous sommes les meilleurs et que nous sommes sur la marche de l’émergence, au risque même de harasser les puristes de l’économie du développement qui savent ce qu’émerger veut dire. Car le jour où notre pays émergera, les Sénégalais le sentiront dans leur vie quotidienne, à travers l’amélioration de leur bien-être et la création d’opportunités nouvelles d’éducation, de santé, d’emplois et de revenus pour tous.
Aujourd’hui, il est temps de faire notre introspection et de tirer les leçons de la gestion des 54 ans de souveraineté retrouvée.
En 1960, lorsque le Sénégal prenait son destin en main, il héritait d’un patrimoine constitué d’un actif et d’un passif. L’actif était composé d’infrastructures modernes (port, routes et chemin de fer, bâtiments administratifs), d’institutions administratives de qualité et d’une base industrielle de dimension sous-regionale. Le passif, c’était une structuration de l’économie sur la base des intérêts de la métropole, la concentration de l’effort d’investissement public et de modernisation à Dakar et à Saint Louis, ainsi qu’une énorme demande sociale non satisfaite en éducation, en santé, en logement et en emplois.
Pour prendre en charge ces défis titanesques, les premiers dirigeants du pays (Léopold S. Senghor et Mamadou Dia, puis le Président Senghor tout seul) ont mis en œuvre, avec détermination et volontarisme, leur théorie du socialisme africain qui comportait, parmi ses composantes, la planification impérative, un encadrement très serré des paysans (grâce au système des coopératives) et la nationalisation des entreprises.
Au bilan, cette politique interventionniste a permis de former les Sénégalais à la gestion agricole et d’améliorer leurs conditions sociales, de mettre les grandes industries (huileries notamment) au service des intérêts de la nation, de propulser la culture et la diplomatie sénégalaises sur la scène internationale, ainsi que de bâtir un Etat structuré animé par des hauts fonctionnaires d’élite.
Mais, elle a aussi engendré de profonds déséquilibres des finances publiques et favorisé l’éclosion d’une logique d’assistanat chez les populations, inhibant ainsi l’initiative privée et l’esprit d’entreprise.
Il revenait au Président Abdou Diouf de gérer cet héritage, positif et négatif à la fois, dans le cadre du concept devenu célèbre de « changement dans la continuité ». Les programmes de stabilisation et d’ajustement, mis en œuvre pour corriger les imperfections constatées, se sont révélés globalement inefficaces, d’une part, en raison de leur incohérence et des erreurs de programmations de mesures (cas de la nouvelle politique agricole et de la nouvelle politique industrielle), et, d’autre part, en raison du manque de volonté politique pour appliquer les mesures de réforme ayant le plus d’incidence sociale. L’on a alors pu parler d’ajustement différé, justifiant la rupture entre le Sénégal et ses bailleurs au début des années 1990.
Le Président Diouf a su rebondir en impulsant au pays et en faisant accepter aux syndicats de travailleurs, une vague sans précédent de réformes, peu avant et, surtout, après la dévaluation. La libéralisation économique et le désengagement de l’Etat devenaient le leitmotiv. La politique vertueuse poursuivie, et soutenue par les partenaires au développement, a permis de relancer fortement la croissance économique et les investissements publics, notamment en zone rurale.
Toutefois, la population, impatiente de sortir de la pauvreté, n’a pas voulu considérer les progrès réalisés par l’équipe du Président Diouf et a, de manière très nette, plébiscité un nouveau régime dirigé par le Président Abdoulaye Wade.
Se proclamant du libéralisme, le Président Wade a mis l’accent sur l’attraction des investissements privés, notamment étrangers. Il a ainsi identifié plusieurs grands projets qu’il s’est évertué lui-même à promouvoir auprès des milieux d’affaires internationaux, avec l’aide d’une nouvelle Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux. M. Macky Sall, élu en 2012, n’a pas remis en cause ces nouvelles orientations.
Cette option de politique libérale, parce que la mondialisation la rend désormais incontournable, doit être maintenue dans son principe et elle me semble acceptée par les partis politiques susceptibles d’alterner à la tête du pays. Toutefois, elle ne saurait constituer une solution viable si elle se limite au laisser-faire, rejoignant la thèse de certains néo-libéraux.
L’expérience de tous les pays qui ont récemment émergé (Singapour et Malaisie par exemple), montre que le développement ne peut subvenir sans une régulation lucide de l’Etat qui a la haute responsabilité d’organiser l’effort de croissance économique, dans le cadre d’une stratégie pensée et exécutée dans les règles de l’art, et de mettre en place les investissements d’attrait et d’accompagnement des investisseurs.
En particulier, la promotion de la destination Sénégal auprès du capital étranger, aujourd’hui portée en haute priorité, ne pourra se révéler réellement efficace que si l’Etat veille au préalable à aligner l’environnement des affaires au Sénégal sur les standards internationaux (notamment une bonne politique macro-économique, un cadre politique et social apaisé, des institutions administratives et juridiques intègres et transparentes qui facilitent les formalités et procédures des investisseurs, des ressources humaines formées et compétitives, des infrastructures de qualité, un secteur privé local entreprenant et dynamique); or, l’analyse montre que, sur plusieurs de ces facteurs, notre situation est encore très en deçà des normes, surtout si l’on nous compare aux pays asiatiques et africains qui sont directement en compétition avec nous.
Ainsi, pour un pays pauvre comme le Sénégal où tout reste à mettre à niveau, le bon Policy-mix doit forcément faire converger liberté et régulation, marché et Etat-stratège, incitation et volontarisme.
Aujourd’hui, le pays se retrouve dans un cycle, sans élection programmée pour au moins deux ans et demi. Cette situation favorable doit être utilisée pour marquer un tournant, mettre la politique aux vestiaires et engager le pays dans une nouvelle étape, celle des réformes véritables seules à même de changer notre futur. Un futur qui doit nous mener, en une décennie, à l’émergence économique et sociale.
Mais, pour changer notre futur, il nous faut commencer par changer notre présent qui se décline en cinq handicaps structurels majeurs (1) que nous devons corriger sans tarder :
1. La politique politicienne est trop présente
Le changement ne peut pas réussir dans un environnement où la politique politicienne est omniprésente dans la préoccupation des dirigeants, comme c’est le cas au Sénégal. L’équipe du président Sall semble ainsi plus obnubilée par la consolidation de ses soutiens partisans et par sa réélection, en déclinant, chaque jour que Dieu fait, une nouvelle manœuvre politique (dont le résultat est tout sauf certain sur le comportement futur des électeurs), plutôt que par le travail inlassable pour accélérer les réformes promises, favoriser la création d’emplois et sortir les Sénégalais des difficultés quotidiennes. Tandis que les dirigeants des pays qui aspirent sérieusement à l’émergence passent leur week-end à accélérer les dossiers de l’Etat, sous nos cieux, les samedi et dimanche servent principalement à réunir les « alliés » au Palais de la République ou dans les grands hôtels, en leur promettant des « salaires mensuels » en contrepartie de leurs soutiens.
De fait, le »Yoonu Yokkuté » cède ainsi, petit à petit, la place au « Yoonu Falouwaat». Et, si les choses restent en l’état et que les attentes de bien-être demeurent insatisfaites, il est fort probable qu’il n’y ait ni « yokkuté » ni « falouwaat », l’un déterminant l’autre. Et le peuple sera alors obligé de chercher un nouveau départ dans un peu moins de trois ans, en espérant que cette fois-ci sera la bonne.
2. Nous ne savons transformer nos visions en actions
Le Sénégal peut être décrit comme le pays des occasions manquées. Qu’on en juge : incapacité à exploiter les opportunités offertes par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, tergiversations dans la mise en place d’une stratégie industrielle axée sur les grappes, suspension de l’idée de faire de Dakar une ville de services, retard dans la réalisation du technopôle, retard dans la mise en œuvre concrète du Plan Sénégal Emergent (qui est d’ailleurs plus une liste de projets qu’un Plan digne de ce nom), inaptitude à convaincre de grands investisseurs étrangers de passer à l’acte, malgré notre stabilité politique, et j’en passe. On peut même avancer, sans risque énorme de se tromper, qu’il n’y a pas un seul domaine du développement qui n’ait pas fait l’objet de réflexions et de résolutions au Sénégal, mais plusieurs d’entre elles dorment encore dans les tiroirs, si elles n’ont pas inspiré d’autres pays qui ont pris la peine de les appliquer effectivement. Serions-nous juste une terre de « brainstorming » et d’expérimentation?
Ce défaut de perspicacité et cette difficulté à mener à terme certains de nos projets et de nos programmes, parmi les plus décisifs pour faire la différence, quoique parfois expliquées par des contraintes spécifiques, sont inacceptables dans ce monde de la vitesse et de l’innovation où « celui qui n’avance pas recule », pour paraphraser Einstein qui comparait la vie à une bicyclette.
Pendant ce temps, des pays (Malaisie, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Tunisie, Maurice, pour ne citer que ceux là), qui avaient pris le même départ que nous en 1960 et qui n’ont rien de fondamental en plus, évoluent, année après année, vers les sommets de la prospérité et de l’intégration dans l’économie mondiale, tandis que nous peinons encore à satisfaire la demande sociale des populations.
3. Notre peuple n’est pas mobilisé
Rien ne peut se faire de grand sans la mobilisation des populations qui doivent se sentir pleinement concernées par le défi du développement. Il est donc temps de nous ressaisir, de développer les capacités des Sénégalais et de les faire adhérer aux valeurs positives. L’objectif poursuivi, à cet effet, doit être, à travers une refondation culturelle, de créer un nouveau type de Sénégalais (2) compétents et en phase avec les exigences du monde moderne, disciplinés et compétitifs, entreprenants et prêts à se prendre en charge eux-mêmes avant de compter sur l’Etat ou sur les autres.
Il est en effet incontestable que nos compatriotes sont talentueux et imbus de multiples qualités que la société leur a inculquées. Mais, il est tout aussi notable qu’un certain laisser-aller se retrouve chez les étudiants lorsqu’ils vont en grève pour un rien, harcèlent les autorités publiques, demandent des privilèges sans se soucier du poids de ces requêtes pour la société ni de leur avenir ni du désespoir que vivent les pauvres en zone rurale ou péri-urbaine. Toute velléité de réforme est tuée dans l’œuf par les protestations et les menaces de sanction dans les urnes. Or, c’est faire preuve de leadership que de savoir prendre ses responsabilités quand il le faut, en usant, au maximum, de la négociation et, si nécessaire, de la fermeté. Le peuple, dans sa grande sagesse, saura, à terme, reconnaître les fondements des décisions ainsi prises et en rendre grâce à ses leaders.
La même incompréhension vaut pour le jeune chômeur qui croise les bras, accusant l’Etat de tous les maux, et n’entreprend aucune démarche pour s’en sortir, pour le syndicaliste lorsqu’il préfère la confrontation au dialogue au sein de l’entreprise, pour l’hommes d’affaires qui ne compte que sur le soutien de l’Etat pour réussir, plutôt que sur l’imagination et le travail, pour le chef d’entreprise qui pille les ressources de sa société pour s’enrichir personnellement, pour le fonctionnaire qui ne se préoccupe guère de la mission de service au public qui lui est confié, pour le parent qui laisse sa progéniture errer et quémander dans le centre-ville de Dakar, pour l’homme politique qui préfère les attaques personnelles au débat d’idées, pour le citoyen « lamda » qui ne pense qu’à ses intérêts et s’oppose vigoureusement à toute mesure de réforme qui lui est défavorable même si celle-ci est bénéfique pour toute la société
Il suffit de se promener autour de la place de l’indépendance à Dakar pour expérimenter de visu tous les méfaits causés par des attitudes de cette nature : immondices déposés à certains endroits, installation des marchands à la sauvette et de jeunes mendiants devant les banques, harcèlement des passants et des touristes. Si de telles attitudes devaient perdurer, le futur du Sénégal serait préoccupant, car l’expérience montre que ces comportements sont incompatibles avec les exigences du progrès humain et les vertus d’une société sophistiquée et moderne.
Il n’est donc que temps de nous réformer, tous ensemble, sous la houlette du leadership qui devra lui-même montrer l’exemple et définir une stratégie pour développer le savoir et le savoir-faire des Sénégalais, leur inculquer et les faire adhérer aux valeurs de l’éthique du travail, du professionnalisme et de la rigueur, de la discipline et du civisme.
Pour cela, il est important que les pouvoirs publics évitent de jouer la facilité dans leurs rapports avec les citoyens, leur fassent sentir que le pays est véritablement en crise et qu’il y a urgence à agir, les poussent à transcender les difficultés du passé, à avoir confiance en leurs capacités et à inventer un autre futur, et, surtout, mettent la pression sur eux pour qu’ils déploient leurs énergies jusqu’à la limite. Les Sénégalais sont tout à fait prédisposés à adopter les attitudes nécessaires pour développer leur pays, pour peu que les pouvoirs publics les convainquent d’en faire autant, par leur cohérence sur la durée, leur vertu et leur compétence.
4. Notre administration n’est pas préparée pour relever le défi du développement
Les fonctionnaires sénégalais sont connus pour leur expertise et leur sens du service. Toutefois, ils ne sont ni motivés, ni formés, ni armés, moralement et matériellement, pour conduire le changement. Mal rémunérés, nommés de manière discrétionnaire et pouvant être relevés à tout moment, les directeurs d’administration, centrale ou locale, ne possèdent guère la visibilité pour proposer et mettre en œuvre des réformes tendant à améliorer la qualité des services rendus aux usagers.
Il importe dès lors d’introduire une nouvelle politique de gestion des ressources humaines dans la fonction publique, mettant l’accent sur la promotion de l’excellence, le transfert à la gestion privée ou semi-publique de tout ce qui peut l’être dans les fonctions actuelles de l’Etat (« principe de subsidiarité »), l’amélioration des conditions matérielles des agents, la mise à niveau perpétuelle des connaissances et la conclusion de contrats de performances sur la durée à tous les niveaux hiérarchiques.
5. Nous n’avons pas de stratégie véritable pour nous insérer dans la globalisation
L’économie sénégalaise reste irrémédiablement dominée par l’exploitation de ressources naturelles à faible valeur ajoutée (produits de la pêche, arachide, phosphates et tourisme qui constituent l’essentiel des exportations). Cette tendance lourde, qui prend appui sur les avantages comparatifs et les facteurs de base du Sénégal, est à la source de bien de nos difficultés (1).
Car, dans le nouvel environnement mondial, où c’est le savoir-faire qui est échangé plus que les ressources et les biens physiques, ne peuvent prospérer que les pays qui disposent d’une vue claire de leurs atouts et de leurs avantages compétitifs ainsi que de leurs faiblesses, qui veillent à mettre sur pied un environnement économique de standard international et à capter les meilleures pratiques (« benchmarking »).
Ces pays poussent aussi leurs firmes nationales à développer des stratégies de dimension mondiale et à coopérer entre elles plutôt qu’à se disputer les rentes de l’Etat et le maigre marché intérieur, à améliorer leur position compétitive et leur productivité, à identifier et à satisfaire, avec des produits sophistiqués et diversifiés, les besoins des consommateurs mondiaux, en éliminant autant que possible les intermédiaires -notamment en utilisant les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Ne pas avoir de stratégie innovante de cette nature et demeurer dans ses anciens paradigmes, c’est se condamner à la pauvreté et à l’exclusion des échanges mondiaux, comme les pays africains sont en train d’en faire l’amère expérience.
En définitive, notre rêve commun est que la prochaine génération de Sénégalais n’ait pas besoin de tendre la main au monde pour survivre et perdre ainsi de sa dignité. Dans une Afrique qui peine à se développer, nous pouvons faire du Sénégal une oasis de prospérité, imitable par les autres, à condition de nous en donner franchement les moyens. En vérité, le « Sénégal qui gagne », c’est uniquement le Sénégal qui émerge de la pauvreté.
Note :
(1) L’économiste Dani Rodrik de l’Université de Harvard suggère aux pays pauvres qui aspirent à l’émergence, de pas de chercher à corriger toutes leurs faiblesses à la fois, mais d’identifier, à travers un diagnostic stratégique, les obstacles les plus sérieux qui freinent leur compétitivité internationale, puis d’engager les réformes prioritaires ayant le plus d’impact sur la croissance. Par exemple, pour l’Inde, en 1980, la principale contrainte résidait dans ce que l’État était perçu comme un acteur hostile au secteur privé; pour la Chine, en 1978, la contrainte était l’absence d’incitations orientées vers le marché. Pour le Sénégal, les contraintes fondamentales sont celles listées dan ce texte. Une fois la dynamique de croissance enclenchée, les réformes pourront être accélérées et leurs coûts distribués sur la durée.
(2) Nouveau type de Sénégalais, terme que j’ai utilisé dans le chapitre intitulé « réinventer le Sénégal » de mon livre « le Sénégal émergent », publié en mars 2003, Ed. Wal Fadjri.
(3) Pour une analyse plus générale sur les liens entre pauvreté et mauvais choix stratégiques, voir le livre « Plowing the sea : nurturing the hidden sources of growth in developing world » écrit par Michael Fairbanks et Stace Lindsay, publié aux éditions Harvard Business School Press.
Certes, un frémissement a pu être noté récemment, avec des performances en termes de croissance supérieures à 5% par an en moyenne sur le continent. Mais, celles-ci demeurent encore insuffisantes pour propulser la grande majorité des pays africains sur la rampe de l’émergence.
Aujourd’hui ces pays peuvent être classés en quatre groupes :
➢ premier groupe : celui des pays dont les dirigeants ignorent qu’ils doivent mener le changement ou qui n’en sont pas convaincus pour des motifs idéologiques ou encore qui ne peuvent pas l’engager pour des raisons indépendantes de leur volonté (cas des pays qui connaissent des guerres civiles comme la Somalie). Avec la normalisation politique progressive, ce groupe a perdu beaucoup de ses adeptes. On intitulera ce groupe celui des « résistants-incapables de changement » ;
➢ deuxième groupe : celui des pays dont les dirigeants savent que le changement s’impose, qui peuvent le décréter mais qui préfèrent ne pas s’y embarquer, par peur de saper leur base populaire ou leurs privilèges.
Plusieurs pays à économie rentière, dirigés par des chefs d’Etat théocratiques, se retrouvent dans ce cas. Ne pouvant toujours résister aux pressions des partenaires au développement, ces dirigeants n’accordent qu’un soutien vague et limité aux réformes, les ajournent sans cesse et/ou ne les appliquent que de manière partielle et incomplète. Ce groupe pourrait s’appeler celui des «conservateurs-populistes»;
➢ troisième groupe : celui des pays qui croient sincèrement aux vertus du changement, mais qui ne savent pas le réussir, car ne s’étant aménagé au préalable ni les capacités ni les moyens pour transformer leurs rêves en réalités ; un nombre de plus en plus élevé de pays africains se retrouvent dans cette catégorie, avec des niveaux gradués de performances. Nous les appellerons les « réformistes-utopistes » ;
➢ enfin, le quatrième groupe, très réduit dans sa composition, des pays qui non seulement savent lire les lignes d’horizon et définir une vision, mais s’appliquent quotidiennement à atteindre le but fixé et à améliorer réellement leur situation, par la mise en œuvre effective d’une stratégie et d’un plan d’actions efficace et maîtrisé. Ce groupe est celui des « champions du changement ». On peut y compter l’Ile Maurice et le Rwanda.
Une question se pose à ce niveau. Où classer le Sénégal ? Certainement pas dans le premier groupe. S’il est en effet un point sur lequel toute la classe politique sénégalaise s’accorde, c’est la nécessité de changer le destin de notre pays, l’intégrer pleinement dans l’économie mondiale et offrir des perspectives plus reluisantes à ses filles et à ses fils.
Mais, au delà de la rhétorique, le changement doit se manifester dans les faits et aboutir à des résultats visibles et palpables. En jugeant les faits, et uniquement les faits, force est de constater que nous ne pouvons pas encore prétendre au groupe des « champions du changement » (le quatrième groupe). Si tel était le cas, les Sénégalais l’auraient ressenti dans leur vie quotidienne.
Or que nous disent les chiffres ? Selon les statistiques officielles (ANSD, comptes nationaux et recensement de la population en 2013), la croissance économique dépasse à peine 3% en moyenne depuis 2006, plus de deux Sénégalais sur cinq sont considérés comme pauvres, 20% des enfants ne fréquentent pas l’école primaire, 54% la population est analphabète, plus d’un Sénégalais sur quatre est au chômage (et beaucoup d’autres en situation de sous-emploi), 26,2% n’ont pas accès à une eau potable, 42,5% n’ont pas accès à l’électricité, le risque pour un enfant de décéder avant le premier anniversaire est de 53 pour mille, le taux mortalité maternelle est de 434 décès pour 100.000 naissances vivantes. Toutes ces données économiques et sociales constituent des contre-performances notables, même si des progrès sont constatés pour certains indicateurs.
Au mieux, nous ne pouvons donc nous comptabiliser que dans le troisième groupe (celui des « réformistes utopistes »). Et encore, dans certains domaines – en particulier, pour tout ce qui remet en cause des avantages acquis-, il y a, depuis bien longtemps, mise à part la période de la dévaluation pendant laquelle une politique courageuse a été mise en œuvre, comme une inertie qui fait perdurer le statu-quo et le consensus ante (attitude préférée des pays du deuxième groupe) au détriment du mouvement.
Ainsi nous manquons toujours de stratégie cohérente au niveau industriel, de programme pour transformer les paysans en acteurs dynamiques de l’émergence et insérer notre économie dans les échanges mondiaux. Au surplus, nous n’offrons ni accompagnement digne de ce nom à l’insertion professionnelle des diplômés, ni modèle de société aux jeunes, les laissant se débrouiller seuls pour rechercher un travail et se fixer eux-mêmes leurs propres valeurs.
Partout, nous préférons différer les réformes, s’attacher à l’accessoire plutôt qu’à l’essentiel, toucher la corde sensible du peuple plutôt que le pousser à être productif et compétitif. Et, tant que nous nous contenterons de solutions partielles et éviterons les sujets qui fâchent ou qui demandent des efforts difficiles sur la durée, nous continuerons, en dépit de nos innombrables atouts, de jouer dans la cour des pays pauvres et sans espoir.
Partout, nous préférons croire au miracle, nous dire inlassablement que nous sommes les meilleurs et que nous sommes sur la marche de l’émergence, au risque même de harasser les puristes de l’économie du développement qui savent ce qu’émerger veut dire. Car le jour où notre pays émergera, les Sénégalais le sentiront dans leur vie quotidienne, à travers l’amélioration de leur bien-être et la création d’opportunités nouvelles d’éducation, de santé, d’emplois et de revenus pour tous.
Aujourd’hui, il est temps de faire notre introspection et de tirer les leçons de la gestion des 54 ans de souveraineté retrouvée.
En 1960, lorsque le Sénégal prenait son destin en main, il héritait d’un patrimoine constitué d’un actif et d’un passif. L’actif était composé d’infrastructures modernes (port, routes et chemin de fer, bâtiments administratifs), d’institutions administratives de qualité et d’une base industrielle de dimension sous-regionale. Le passif, c’était une structuration de l’économie sur la base des intérêts de la métropole, la concentration de l’effort d’investissement public et de modernisation à Dakar et à Saint Louis, ainsi qu’une énorme demande sociale non satisfaite en éducation, en santé, en logement et en emplois.
Pour prendre en charge ces défis titanesques, les premiers dirigeants du pays (Léopold S. Senghor et Mamadou Dia, puis le Président Senghor tout seul) ont mis en œuvre, avec détermination et volontarisme, leur théorie du socialisme africain qui comportait, parmi ses composantes, la planification impérative, un encadrement très serré des paysans (grâce au système des coopératives) et la nationalisation des entreprises.
Au bilan, cette politique interventionniste a permis de former les Sénégalais à la gestion agricole et d’améliorer leurs conditions sociales, de mettre les grandes industries (huileries notamment) au service des intérêts de la nation, de propulser la culture et la diplomatie sénégalaises sur la scène internationale, ainsi que de bâtir un Etat structuré animé par des hauts fonctionnaires d’élite.
Mais, elle a aussi engendré de profonds déséquilibres des finances publiques et favorisé l’éclosion d’une logique d’assistanat chez les populations, inhibant ainsi l’initiative privée et l’esprit d’entreprise.
Il revenait au Président Abdou Diouf de gérer cet héritage, positif et négatif à la fois, dans le cadre du concept devenu célèbre de « changement dans la continuité ». Les programmes de stabilisation et d’ajustement, mis en œuvre pour corriger les imperfections constatées, se sont révélés globalement inefficaces, d’une part, en raison de leur incohérence et des erreurs de programmations de mesures (cas de la nouvelle politique agricole et de la nouvelle politique industrielle), et, d’autre part, en raison du manque de volonté politique pour appliquer les mesures de réforme ayant le plus d’incidence sociale. L’on a alors pu parler d’ajustement différé, justifiant la rupture entre le Sénégal et ses bailleurs au début des années 1990.
Le Président Diouf a su rebondir en impulsant au pays et en faisant accepter aux syndicats de travailleurs, une vague sans précédent de réformes, peu avant et, surtout, après la dévaluation. La libéralisation économique et le désengagement de l’Etat devenaient le leitmotiv. La politique vertueuse poursuivie, et soutenue par les partenaires au développement, a permis de relancer fortement la croissance économique et les investissements publics, notamment en zone rurale.
Toutefois, la population, impatiente de sortir de la pauvreté, n’a pas voulu considérer les progrès réalisés par l’équipe du Président Diouf et a, de manière très nette, plébiscité un nouveau régime dirigé par le Président Abdoulaye Wade.
Se proclamant du libéralisme, le Président Wade a mis l’accent sur l’attraction des investissements privés, notamment étrangers. Il a ainsi identifié plusieurs grands projets qu’il s’est évertué lui-même à promouvoir auprès des milieux d’affaires internationaux, avec l’aide d’une nouvelle Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux. M. Macky Sall, élu en 2012, n’a pas remis en cause ces nouvelles orientations.
Cette option de politique libérale, parce que la mondialisation la rend désormais incontournable, doit être maintenue dans son principe et elle me semble acceptée par les partis politiques susceptibles d’alterner à la tête du pays. Toutefois, elle ne saurait constituer une solution viable si elle se limite au laisser-faire, rejoignant la thèse de certains néo-libéraux.
L’expérience de tous les pays qui ont récemment émergé (Singapour et Malaisie par exemple), montre que le développement ne peut subvenir sans une régulation lucide de l’Etat qui a la haute responsabilité d’organiser l’effort de croissance économique, dans le cadre d’une stratégie pensée et exécutée dans les règles de l’art, et de mettre en place les investissements d’attrait et d’accompagnement des investisseurs.
En particulier, la promotion de la destination Sénégal auprès du capital étranger, aujourd’hui portée en haute priorité, ne pourra se révéler réellement efficace que si l’Etat veille au préalable à aligner l’environnement des affaires au Sénégal sur les standards internationaux (notamment une bonne politique macro-économique, un cadre politique et social apaisé, des institutions administratives et juridiques intègres et transparentes qui facilitent les formalités et procédures des investisseurs, des ressources humaines formées et compétitives, des infrastructures de qualité, un secteur privé local entreprenant et dynamique); or, l’analyse montre que, sur plusieurs de ces facteurs, notre situation est encore très en deçà des normes, surtout si l’on nous compare aux pays asiatiques et africains qui sont directement en compétition avec nous.
Ainsi, pour un pays pauvre comme le Sénégal où tout reste à mettre à niveau, le bon Policy-mix doit forcément faire converger liberté et régulation, marché et Etat-stratège, incitation et volontarisme.
Aujourd’hui, le pays se retrouve dans un cycle, sans élection programmée pour au moins deux ans et demi. Cette situation favorable doit être utilisée pour marquer un tournant, mettre la politique aux vestiaires et engager le pays dans une nouvelle étape, celle des réformes véritables seules à même de changer notre futur. Un futur qui doit nous mener, en une décennie, à l’émergence économique et sociale.
Mais, pour changer notre futur, il nous faut commencer par changer notre présent qui se décline en cinq handicaps structurels majeurs (1) que nous devons corriger sans tarder :
1. La politique politicienne est trop présente
Le changement ne peut pas réussir dans un environnement où la politique politicienne est omniprésente dans la préoccupation des dirigeants, comme c’est le cas au Sénégal. L’équipe du président Sall semble ainsi plus obnubilée par la consolidation de ses soutiens partisans et par sa réélection, en déclinant, chaque jour que Dieu fait, une nouvelle manœuvre politique (dont le résultat est tout sauf certain sur le comportement futur des électeurs), plutôt que par le travail inlassable pour accélérer les réformes promises, favoriser la création d’emplois et sortir les Sénégalais des difficultés quotidiennes. Tandis que les dirigeants des pays qui aspirent sérieusement à l’émergence passent leur week-end à accélérer les dossiers de l’Etat, sous nos cieux, les samedi et dimanche servent principalement à réunir les « alliés » au Palais de la République ou dans les grands hôtels, en leur promettant des « salaires mensuels » en contrepartie de leurs soutiens.
De fait, le »Yoonu Yokkuté » cède ainsi, petit à petit, la place au « Yoonu Falouwaat». Et, si les choses restent en l’état et que les attentes de bien-être demeurent insatisfaites, il est fort probable qu’il n’y ait ni « yokkuté » ni « falouwaat », l’un déterminant l’autre. Et le peuple sera alors obligé de chercher un nouveau départ dans un peu moins de trois ans, en espérant que cette fois-ci sera la bonne.
2. Nous ne savons transformer nos visions en actions
Le Sénégal peut être décrit comme le pays des occasions manquées. Qu’on en juge : incapacité à exploiter les opportunités offertes par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, tergiversations dans la mise en place d’une stratégie industrielle axée sur les grappes, suspension de l’idée de faire de Dakar une ville de services, retard dans la réalisation du technopôle, retard dans la mise en œuvre concrète du Plan Sénégal Emergent (qui est d’ailleurs plus une liste de projets qu’un Plan digne de ce nom), inaptitude à convaincre de grands investisseurs étrangers de passer à l’acte, malgré notre stabilité politique, et j’en passe. On peut même avancer, sans risque énorme de se tromper, qu’il n’y a pas un seul domaine du développement qui n’ait pas fait l’objet de réflexions et de résolutions au Sénégal, mais plusieurs d’entre elles dorment encore dans les tiroirs, si elles n’ont pas inspiré d’autres pays qui ont pris la peine de les appliquer effectivement. Serions-nous juste une terre de « brainstorming » et d’expérimentation?
Ce défaut de perspicacité et cette difficulté à mener à terme certains de nos projets et de nos programmes, parmi les plus décisifs pour faire la différence, quoique parfois expliquées par des contraintes spécifiques, sont inacceptables dans ce monde de la vitesse et de l’innovation où « celui qui n’avance pas recule », pour paraphraser Einstein qui comparait la vie à une bicyclette.
Pendant ce temps, des pays (Malaisie, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Tunisie, Maurice, pour ne citer que ceux là), qui avaient pris le même départ que nous en 1960 et qui n’ont rien de fondamental en plus, évoluent, année après année, vers les sommets de la prospérité et de l’intégration dans l’économie mondiale, tandis que nous peinons encore à satisfaire la demande sociale des populations.
3. Notre peuple n’est pas mobilisé
Rien ne peut se faire de grand sans la mobilisation des populations qui doivent se sentir pleinement concernées par le défi du développement. Il est donc temps de nous ressaisir, de développer les capacités des Sénégalais et de les faire adhérer aux valeurs positives. L’objectif poursuivi, à cet effet, doit être, à travers une refondation culturelle, de créer un nouveau type de Sénégalais (2) compétents et en phase avec les exigences du monde moderne, disciplinés et compétitifs, entreprenants et prêts à se prendre en charge eux-mêmes avant de compter sur l’Etat ou sur les autres.
Il est en effet incontestable que nos compatriotes sont talentueux et imbus de multiples qualités que la société leur a inculquées. Mais, il est tout aussi notable qu’un certain laisser-aller se retrouve chez les étudiants lorsqu’ils vont en grève pour un rien, harcèlent les autorités publiques, demandent des privilèges sans se soucier du poids de ces requêtes pour la société ni de leur avenir ni du désespoir que vivent les pauvres en zone rurale ou péri-urbaine. Toute velléité de réforme est tuée dans l’œuf par les protestations et les menaces de sanction dans les urnes. Or, c’est faire preuve de leadership que de savoir prendre ses responsabilités quand il le faut, en usant, au maximum, de la négociation et, si nécessaire, de la fermeté. Le peuple, dans sa grande sagesse, saura, à terme, reconnaître les fondements des décisions ainsi prises et en rendre grâce à ses leaders.
La même incompréhension vaut pour le jeune chômeur qui croise les bras, accusant l’Etat de tous les maux, et n’entreprend aucune démarche pour s’en sortir, pour le syndicaliste lorsqu’il préfère la confrontation au dialogue au sein de l’entreprise, pour l’hommes d’affaires qui ne compte que sur le soutien de l’Etat pour réussir, plutôt que sur l’imagination et le travail, pour le chef d’entreprise qui pille les ressources de sa société pour s’enrichir personnellement, pour le fonctionnaire qui ne se préoccupe guère de la mission de service au public qui lui est confié, pour le parent qui laisse sa progéniture errer et quémander dans le centre-ville de Dakar, pour l’homme politique qui préfère les attaques personnelles au débat d’idées, pour le citoyen « lamda » qui ne pense qu’à ses intérêts et s’oppose vigoureusement à toute mesure de réforme qui lui est défavorable même si celle-ci est bénéfique pour toute la société
Il suffit de se promener autour de la place de l’indépendance à Dakar pour expérimenter de visu tous les méfaits causés par des attitudes de cette nature : immondices déposés à certains endroits, installation des marchands à la sauvette et de jeunes mendiants devant les banques, harcèlement des passants et des touristes. Si de telles attitudes devaient perdurer, le futur du Sénégal serait préoccupant, car l’expérience montre que ces comportements sont incompatibles avec les exigences du progrès humain et les vertus d’une société sophistiquée et moderne.
Il n’est donc que temps de nous réformer, tous ensemble, sous la houlette du leadership qui devra lui-même montrer l’exemple et définir une stratégie pour développer le savoir et le savoir-faire des Sénégalais, leur inculquer et les faire adhérer aux valeurs de l’éthique du travail, du professionnalisme et de la rigueur, de la discipline et du civisme.
Pour cela, il est important que les pouvoirs publics évitent de jouer la facilité dans leurs rapports avec les citoyens, leur fassent sentir que le pays est véritablement en crise et qu’il y a urgence à agir, les poussent à transcender les difficultés du passé, à avoir confiance en leurs capacités et à inventer un autre futur, et, surtout, mettent la pression sur eux pour qu’ils déploient leurs énergies jusqu’à la limite. Les Sénégalais sont tout à fait prédisposés à adopter les attitudes nécessaires pour développer leur pays, pour peu que les pouvoirs publics les convainquent d’en faire autant, par leur cohérence sur la durée, leur vertu et leur compétence.
4. Notre administration n’est pas préparée pour relever le défi du développement
Les fonctionnaires sénégalais sont connus pour leur expertise et leur sens du service. Toutefois, ils ne sont ni motivés, ni formés, ni armés, moralement et matériellement, pour conduire le changement. Mal rémunérés, nommés de manière discrétionnaire et pouvant être relevés à tout moment, les directeurs d’administration, centrale ou locale, ne possèdent guère la visibilité pour proposer et mettre en œuvre des réformes tendant à améliorer la qualité des services rendus aux usagers.
Il importe dès lors d’introduire une nouvelle politique de gestion des ressources humaines dans la fonction publique, mettant l’accent sur la promotion de l’excellence, le transfert à la gestion privée ou semi-publique de tout ce qui peut l’être dans les fonctions actuelles de l’Etat (« principe de subsidiarité »), l’amélioration des conditions matérielles des agents, la mise à niveau perpétuelle des connaissances et la conclusion de contrats de performances sur la durée à tous les niveaux hiérarchiques.
5. Nous n’avons pas de stratégie véritable pour nous insérer dans la globalisation
L’économie sénégalaise reste irrémédiablement dominée par l’exploitation de ressources naturelles à faible valeur ajoutée (produits de la pêche, arachide, phosphates et tourisme qui constituent l’essentiel des exportations). Cette tendance lourde, qui prend appui sur les avantages comparatifs et les facteurs de base du Sénégal, est à la source de bien de nos difficultés (1).
Car, dans le nouvel environnement mondial, où c’est le savoir-faire qui est échangé plus que les ressources et les biens physiques, ne peuvent prospérer que les pays qui disposent d’une vue claire de leurs atouts et de leurs avantages compétitifs ainsi que de leurs faiblesses, qui veillent à mettre sur pied un environnement économique de standard international et à capter les meilleures pratiques (« benchmarking »).
Ces pays poussent aussi leurs firmes nationales à développer des stratégies de dimension mondiale et à coopérer entre elles plutôt qu’à se disputer les rentes de l’Etat et le maigre marché intérieur, à améliorer leur position compétitive et leur productivité, à identifier et à satisfaire, avec des produits sophistiqués et diversifiés, les besoins des consommateurs mondiaux, en éliminant autant que possible les intermédiaires -notamment en utilisant les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Ne pas avoir de stratégie innovante de cette nature et demeurer dans ses anciens paradigmes, c’est se condamner à la pauvreté et à l’exclusion des échanges mondiaux, comme les pays africains sont en train d’en faire l’amère expérience.
En définitive, notre rêve commun est que la prochaine génération de Sénégalais n’ait pas besoin de tendre la main au monde pour survivre et perdre ainsi de sa dignité. Dans une Afrique qui peine à se développer, nous pouvons faire du Sénégal une oasis de prospérité, imitable par les autres, à condition de nous en donner franchement les moyens. En vérité, le « Sénégal qui gagne », c’est uniquement le Sénégal qui émerge de la pauvreté.
Note :
(1) L’économiste Dani Rodrik de l’Université de Harvard suggère aux pays pauvres qui aspirent à l’émergence, de pas de chercher à corriger toutes leurs faiblesses à la fois, mais d’identifier, à travers un diagnostic stratégique, les obstacles les plus sérieux qui freinent leur compétitivité internationale, puis d’engager les réformes prioritaires ayant le plus d’impact sur la croissance. Par exemple, pour l’Inde, en 1980, la principale contrainte résidait dans ce que l’État était perçu comme un acteur hostile au secteur privé; pour la Chine, en 1978, la contrainte était l’absence d’incitations orientées vers le marché. Pour le Sénégal, les contraintes fondamentales sont celles listées dan ce texte. Une fois la dynamique de croissance enclenchée, les réformes pourront être accélérées et leurs coûts distribués sur la durée.
(2) Nouveau type de Sénégalais, terme que j’ai utilisé dans le chapitre intitulé « réinventer le Sénégal » de mon livre « le Sénégal émergent », publié en mars 2003, Ed. Wal Fadjri.
(3) Pour une analyse plus générale sur les liens entre pauvreté et mauvais choix stratégiques, voir le livre « Plowing the sea : nurturing the hidden sources of growth in developing world » écrit par Michael Fairbanks et Stace Lindsay, publié aux éditions Harvard Business School Press.










 ACCUEIL
ACCUEIL