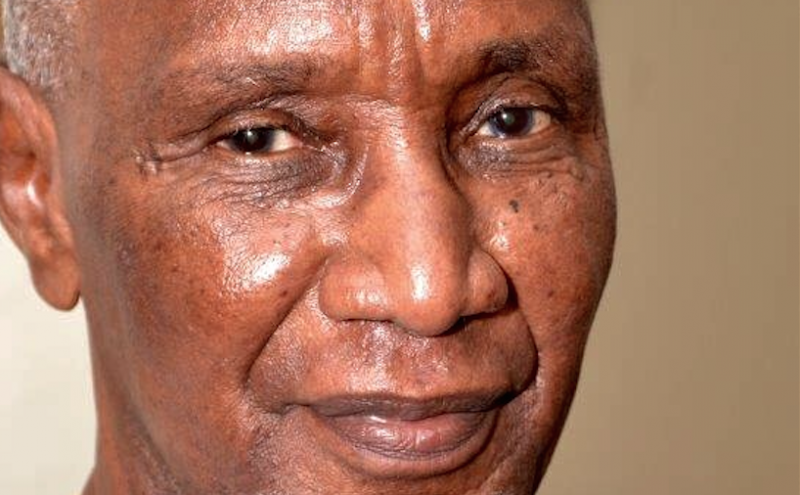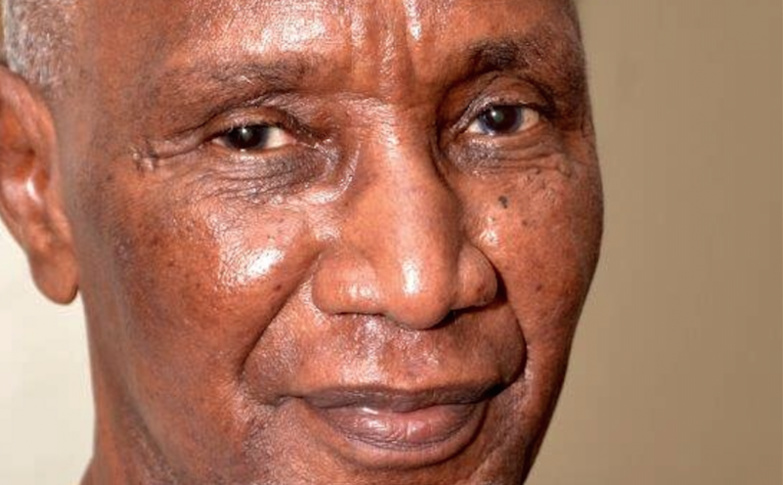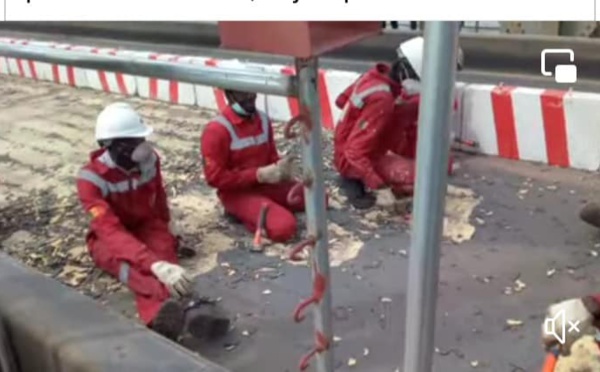Du Carsal (1) à la Convention des Saint-Louisiens (pour ne nous en tenir qu’à une période récente), ils sont légion ces lobbies dont la vocation est de réveiller cette belle endormie qu’est l’ancienne capitale du Sénégal, de lui redonner un peu de son lustre d’antan…Dame : presque quatre cents ans de passé connu et attesté par des documents, c’est sous nos latitudes un gisement exceptionnel, un fonds de commerce dont l’inventaire pourrait remplir plusieurs press-books touristiques alléchants !
Reste à savoir si, obélisques, jets d’eau et empoignades oratoires mis à part, il restera, dans quelques années, quelque chose des prestations de ces militants du Saint-Louis éternel.
De quelle cause d’ailleurs se sont ils faits les champions, eux qui ont, à mon humble avis, le grand tort de ne brandir comme signes de ralliement que Faidherbe et les signares, les «Cahiers de doléances» (2) et la représentation du Sénégal au Parlement français, et par là même, de cultiver un splendide isolement de «minorité ethnique» portant en bandoulière une inguérissable nostalgie ?
Je commencerai par relater quelques scènes vécues. Au milieu des années 1970, j’ai commis dans un périodique publié alors à Saint-Louis (3) une série d’articles consacrés aux noms de rues dans la vieille cité. Je voulais instruire la population sur les illustres inconnus dont les noms ornaient encore les artères de l’ile (4), souligner le caractère quasi accidentel ou anecdotique de certaines dénominations (5), et montrer qu’on pouvait légitimement débaptiser certaines rues et places sans se renier.
Si certains de mes lecteurs approuvèrent, plusieurs notables de la ville m’accusèrent de dénigrement et même de crime de lèse-majesté ! Deux ou trois ans plus tard, alors que j’étais convié par le maire à participer à la cérémonie de jumelage retour entre Lille et Saint-Louis, j’assistais à une scène cocasse. Le maire de la ville natale de Faidherbe invitait celui de la ville à laquelle ce dernier devait sa renommée à renoncer à l’éloge qu’il voulait rendre à l’homme qui avait inspiré le jumelage : « Y en a marre de Faidherbe, nous dit-on sans ambages ! Nous sommes une municipalité socialiste et nous ne pouvons pas nous permettre d’encenser un conquérant colonialiste, un sabreur de populations civiles (6). Si encore on ne parlait que du général républicain, du vainqueur de Bapaume !»
Dix ans après cet évènement, alors que j’accompagnais un ministre de l’Education nationale, militant du réarmement patriotique qui se faisait une fête de donner au vieux lycée Faidherbe le nom d’Oumar Foutiyou Tall, j’assistais, éberlué à la plaidoirie d’une délégation de «cadres saint-louisiens» qui souhaitaient qu’on ne touchât surtout pas au vainqueur de Médine et de Loro…
Pourquoi donc Saint-Louis ne devrait-elle être fière que des marques et des empreintes laissées par le colonisateur ou par son cortège d’explorateurs et de négociants? Pourquoi tiendrait-elle pour négligeables celles imprimées, au prix souvent de beaucoup de sacrifices, par les hommes et les femmes du cru qui se succédèrent sur son sol pendant plusieurs siècles ? Pourquoi notre pays ne mettrait-il pas plutôt en exergue cette évidence : Saint-Louis, c’est la matrice où s’est forgé «l’homme sénégalais»! Elle l’est d’abord parce qu’elle est bâtie à l’entrée du fleuve qui a donné son nom à notre pays, parce que pendant longtemps elle s’est appelée «île du Sénégal», parce que, surtout, c’est sur son sol, sur un ruban de terre d’à peine deux kilomètres de long, que, pour la première fois, se rencontrèrent dans tous les sens du mot, que se mêlèrent, que s’opposèrent quelquefois, que fraternisèrent enfin, le wolof et le manjak, le joola et le pulaar… Il suffit pour s’en convaincre de consulter les registres de recensement général de la population de l’île à la fin du XVIIIe siècle (privilège qui n’appartient qu’à Saint-Louis). Tous les patronymes du Sénégal d’aujourd’hui y figurent : Kan (Kane), Guiouf (Diouf), Guiop (Diop), Gomis…
Aujourd’hui encore le «saint-louisien» ne répond, si l’on ne s’en tient qu’au seul nom de famille, à aucun critère ethnique. Ne nions pas non plus cette évidence : même si par coquetterie ou vantardise nous aimons anticiper la naissance de la «nation sénégalaise», nos frontières modernes sont artificielles, notre pays est une création coloniale dans sa configuration actuelle et c’est à Saint-Louis qu’il y a trois siècles les différences composantes culturelles qui l’habitent ont appris à vivre ensemble. Cela explique sans doute bien des choses et notamment que notre pays ait échappé aux «querelles tribales» qui ont suivi un peu partout la proclamation de l’indépendance.
L’île de Ndar était vierge de tout peuplement permanent à l’arrivée du colonisateur, on peut donc dire que tous ses habitants sont, d’une certaine manière, venus d’ailleurs, de gré ou de force. Saint-Louis c’est notre Amérique, le melting- pot où s’est formée une culture neuve, métissée, en rupture avec les ordres anciens.
Toutes ces raisons devraient inciter tout regroupement de saint-louisiens à être, non un cercle fermé, mais une communauté ouverte, sans exclusive, car on appartient à cette ville moins par la naissance que par la culture. C’est pour cela que nous devrions faire de Saint-Louis notre maison familiale, notre patrimoine commun, souhaiter que chaque sénégalais y ait un point d’ancrage, au lieu que l’ancienne capitale ne soit une enclave étrangère, même au sein de la région qu’elle administre et qu’elle est censée animer. Il y a un autre héritage dont Saint-Louis pourrait aussi s’enorgueillir, c’est l’extraordinaire capacité de résistance dont a fait montre sa population face au colonisateur qui s’était ingénié à la diviser en castes et classes, opposant «hommes de couleur» et «gourmettes», «nègres libres» et «engagés à temps», esclaves et captifs de «case» ou de «traite», «habitants» et étrangers, ces derniers comprenant aussi bien les gens venus du Cayor tout proche que ceux qu’on appelait déjà «Toucouleurs» !
Créée par les Blancs mais peuplée par les Noirs, Saint-Louis a pu ainsi préserver son identité africaine. Au temps de Faidherbe il était interdit aux griots d’y passer la nuit, mais nul n’a jamais réussi à briser la chaine des généalogies dont ils assuraient la survie. On y a organisé des autodafés de gris-gris, pourchassé les marabouts et fermé leurs écoles, mais on n’a pas pu y empêcher la construction d’une mosquée «en dur» dès le milieu du XIXe siècle. C’était une gageure : malgré sa modestie c’est à la fois le plus ancien monument de ce type et de cette nature construit dans la sous-région avec ce matériau et le premier financé par souscription publique ! Pendant des générations seule la minorité européenne et métisse avait le droit, à Saint-Louis, de porter l’appellation «d’Habitants», et pourtant il n’y a pas eu de «kriolisation» de la population, c’est-à-dire de constitution d’une oligarchie dominante avec sa langue et ses rites.
A Saint-Louis, au contraire, les «signares» tenaient des «sabars» et les métis se mettaient au wolof. Même si aux élections législatives de 1914, qui allaient faire date, la vieille cité ne donna pas ses voix à Blaise Diagne, sans doute parce que le ressentiment contre Dakar qui lui avait ravi le titre de capitale de l’AOF ne s’était pas dissipé, c’est de l’île que partit le mouvement de jeunes patriotes, formés pourtant, pour la plupart, à l’école coloniale, qui allaient contribuer à faire du Goréen le premier député noir du Sénégal ! Ce sont donc les saint-louisiens qui ont assimilé le colonisateur et non l’inverse et c’est une prouesse que leur cité, porte drapeau de la présence française en Afrique de l’ouest, soit devenue le symbole de la plus médiatique des valeurs sénégalaises : la «téranga» !
Alors, pourquoi, avec tant d’atouts, ne peut-on se permettre de démomifier Saint-Louis ? Pourquoi cette ville ne cesserait-elle pas de toujours donner l’impression d’être une cité recroquevillée dans son passé, frileuse, toute confinée dans une histoire qui, quelquefois la concerne si peu ? Pourquoi ne se muerait-elle pas en une cité conquérante et ne ferait-elle pas plus de place à l’héritage vivant de ceux qui lui ont donné leur sang et leur sueur plutôt qu’au souvenir d’un passé à jamais enfoui ? Pourquoi, pour tout dire, ne pas enterrer Saint-Louis, qui est le nom de plusieurs dizaines de villes dans le monde, et redonner vie à Ndar, nom qui appartient à notre patrimoine et qui a une histoire ?
Oui, nous pouvons déboulonner la statue du général Faidherbe sans que le ciel nous tombe sur la tête, nous pouvons débaptiser la place et le pont qui portent son nom, et qui ne sont pas ses créations, sans attenter à l’histoire et surtout à l’Histoire !
Et puis sachons raison garder : le Saint-Louis hérité de la colonisation française n’est ni la Carthagène des Indes ni la Quito d’Equateur héritées de l’occupation espagnole (7). A l’exception du pont métallique (8) il n’y a pas sur l’île de monument qui mérite d’être inscrit à l’inventaire du patrimoine national au point d’être totalement intouchable. Je ne veux pas dire par là qu’on peut mettre à bas tous ses vieux édifices, je veux seulement dire que nous devons reconnaître que, l’âge, le climat, les déboires économiques aidant, plus aucun d’entre eux ne constitue aujourd’hui un modèle achevé et intact des constructions à argamasse de la période faste.
L’important, aujourd’hui, c’est de redonner à la vieille cité l’harmonie et la grâce dont avaient peut-être rêvé les plus inspirés de ses bâtisseurs ainsi que cette patine qui est la marque d’une longue existence, de restituer la divine surprise qu’ont dû éprouver ceux qui descendaient le fleuve et venaient d’un monde où dominent la paille et l’argile, et qui au détour d’une courbe, ont vu la ville de Saint-Louis surgir au-dessus de l’eau. Il faut restituer Saint-Louis à l’histoire et rendre à Ndar ce qui lui appartient et qui non seulement survivra au pic des démolisseurs, mais pourrait encore remplir une enviable corbeille de mariage ou inspirer un risorgimento salvateur. Ce qui appartient à Ndar c’est ce site improbable et aujourd’hui menacé, entre mer et rivières, avec vue imprenable sur l’infini, avec, sur plusieurs kilomètres, le fleuve Sénégal qui frôle la côte sans se décider à rejoindre l’Atlantique, faisant sa coquette comme le paon fait la roue.
Mais la perfide mer se vengera de ces simagrées en plantant une infranchissable «barre» à son embouchure. Ce qui appartient à Ndar c’est aussi cette mince et étroite pellicule de sable et d’argile, à la jonction du désert et de la mangrove, conquise sur les marées et la vase, longtemps hérissée de bâtisses blanches et carrées qui lui donnaient l’air d’une cité méditerranéenne exilée sous les tropiques. Ce qui appartient à Ndar c’est cette douceur de vivre qui y ramène les retraités et qui y retient les femmes : nulle part au Sénégal celles -ci ne sont aussi sûres d’elles-mêmes, et nulle part les mères ne sont autant aimées. C’est cette civilité qui est probablement le fruit du modus vivendi imposé par la rencontre d’hommes et de femmes d’origine sociale et ethnique aussi diverse. Ce qui appartient à Ndar c’est, enfin, cette nostalgie dont elle aura toujours à revendre…
(1) Comité d’Action pour la Rénovation de Saint-Louis
(2) Probablement l’une des plus tenaces supercheries de l’histoire coloniale du Sénégal, que Senghor a contribué à répandre. Il ne s’agissait en fait que du manifeste d’un négociant qui revendiquait une plus grande liberté de commerce et nullement l’émancipation des esclaves.
(3) Il s’agissait du Bulletin de la Chambre de Commerce.
(4) Qui, même en France, se souvient du Baron Hyde de Neuville dont le nom avait été donné à la principale artère du sud de l’île et qui ne devait ce privilège qu’au fait qu’il était Ministre de la Marine, donc chargé des colonies ?
(5) Comme la rue Navarin, toujours au sud, nom d’une modeste victoire navale française sur les Turcs (1827) qui eut lieu au moment même où l’on baptisait pour la première fois des rues à Saint-Louis.
(6) A titre d’exemples : en 1857 Faidherbe fait bombarder tous les villages du Fouta situés au bord du fleuve Sénégal, de Nguidjilogne à Dembancané, soit sur 150 km ; en mars 1861 il fait incendier 25 villages du Cayor, entre Kelle et Mekhé etc.
(7) En 1838 il y avait à Saint-Louis 310 maisons de briques, de qualité très inégale, et 3000 cases dont 2/3 en paille ; en 1870 la ville comptait 500 maisons en briques et encore 4000 cases !
(8) Rappelons tout de même que le pont d’origine a été remplacé, il y a quelques années, par un pont neuf construit à l’identique.
NB : La mention indiquant que le pont Faidherbe a été reconstruit n’était évidemment pas dans le texte d’origine, publié il y a plus de 25 ans dans Nouvel Horizon. De même que l’explication du sigle Carsal.
Reste à savoir si, obélisques, jets d’eau et empoignades oratoires mis à part, il restera, dans quelques années, quelque chose des prestations de ces militants du Saint-Louis éternel.
De quelle cause d’ailleurs se sont ils faits les champions, eux qui ont, à mon humble avis, le grand tort de ne brandir comme signes de ralliement que Faidherbe et les signares, les «Cahiers de doléances» (2) et la représentation du Sénégal au Parlement français, et par là même, de cultiver un splendide isolement de «minorité ethnique» portant en bandoulière une inguérissable nostalgie ?
Je commencerai par relater quelques scènes vécues. Au milieu des années 1970, j’ai commis dans un périodique publié alors à Saint-Louis (3) une série d’articles consacrés aux noms de rues dans la vieille cité. Je voulais instruire la population sur les illustres inconnus dont les noms ornaient encore les artères de l’ile (4), souligner le caractère quasi accidentel ou anecdotique de certaines dénominations (5), et montrer qu’on pouvait légitimement débaptiser certaines rues et places sans se renier.
Si certains de mes lecteurs approuvèrent, plusieurs notables de la ville m’accusèrent de dénigrement et même de crime de lèse-majesté ! Deux ou trois ans plus tard, alors que j’étais convié par le maire à participer à la cérémonie de jumelage retour entre Lille et Saint-Louis, j’assistais à une scène cocasse. Le maire de la ville natale de Faidherbe invitait celui de la ville à laquelle ce dernier devait sa renommée à renoncer à l’éloge qu’il voulait rendre à l’homme qui avait inspiré le jumelage : « Y en a marre de Faidherbe, nous dit-on sans ambages ! Nous sommes une municipalité socialiste et nous ne pouvons pas nous permettre d’encenser un conquérant colonialiste, un sabreur de populations civiles (6). Si encore on ne parlait que du général républicain, du vainqueur de Bapaume !»
Dix ans après cet évènement, alors que j’accompagnais un ministre de l’Education nationale, militant du réarmement patriotique qui se faisait une fête de donner au vieux lycée Faidherbe le nom d’Oumar Foutiyou Tall, j’assistais, éberlué à la plaidoirie d’une délégation de «cadres saint-louisiens» qui souhaitaient qu’on ne touchât surtout pas au vainqueur de Médine et de Loro…
Pourquoi donc Saint-Louis ne devrait-elle être fière que des marques et des empreintes laissées par le colonisateur ou par son cortège d’explorateurs et de négociants? Pourquoi tiendrait-elle pour négligeables celles imprimées, au prix souvent de beaucoup de sacrifices, par les hommes et les femmes du cru qui se succédèrent sur son sol pendant plusieurs siècles ? Pourquoi notre pays ne mettrait-il pas plutôt en exergue cette évidence : Saint-Louis, c’est la matrice où s’est forgé «l’homme sénégalais»! Elle l’est d’abord parce qu’elle est bâtie à l’entrée du fleuve qui a donné son nom à notre pays, parce que pendant longtemps elle s’est appelée «île du Sénégal», parce que, surtout, c’est sur son sol, sur un ruban de terre d’à peine deux kilomètres de long, que, pour la première fois, se rencontrèrent dans tous les sens du mot, que se mêlèrent, que s’opposèrent quelquefois, que fraternisèrent enfin, le wolof et le manjak, le joola et le pulaar… Il suffit pour s’en convaincre de consulter les registres de recensement général de la population de l’île à la fin du XVIIIe siècle (privilège qui n’appartient qu’à Saint-Louis). Tous les patronymes du Sénégal d’aujourd’hui y figurent : Kan (Kane), Guiouf (Diouf), Guiop (Diop), Gomis…
Aujourd’hui encore le «saint-louisien» ne répond, si l’on ne s’en tient qu’au seul nom de famille, à aucun critère ethnique. Ne nions pas non plus cette évidence : même si par coquetterie ou vantardise nous aimons anticiper la naissance de la «nation sénégalaise», nos frontières modernes sont artificielles, notre pays est une création coloniale dans sa configuration actuelle et c’est à Saint-Louis qu’il y a trois siècles les différences composantes culturelles qui l’habitent ont appris à vivre ensemble. Cela explique sans doute bien des choses et notamment que notre pays ait échappé aux «querelles tribales» qui ont suivi un peu partout la proclamation de l’indépendance.
L’île de Ndar était vierge de tout peuplement permanent à l’arrivée du colonisateur, on peut donc dire que tous ses habitants sont, d’une certaine manière, venus d’ailleurs, de gré ou de force. Saint-Louis c’est notre Amérique, le melting- pot où s’est formée une culture neuve, métissée, en rupture avec les ordres anciens.
Toutes ces raisons devraient inciter tout regroupement de saint-louisiens à être, non un cercle fermé, mais une communauté ouverte, sans exclusive, car on appartient à cette ville moins par la naissance que par la culture. C’est pour cela que nous devrions faire de Saint-Louis notre maison familiale, notre patrimoine commun, souhaiter que chaque sénégalais y ait un point d’ancrage, au lieu que l’ancienne capitale ne soit une enclave étrangère, même au sein de la région qu’elle administre et qu’elle est censée animer. Il y a un autre héritage dont Saint-Louis pourrait aussi s’enorgueillir, c’est l’extraordinaire capacité de résistance dont a fait montre sa population face au colonisateur qui s’était ingénié à la diviser en castes et classes, opposant «hommes de couleur» et «gourmettes», «nègres libres» et «engagés à temps», esclaves et captifs de «case» ou de «traite», «habitants» et étrangers, ces derniers comprenant aussi bien les gens venus du Cayor tout proche que ceux qu’on appelait déjà «Toucouleurs» !
Créée par les Blancs mais peuplée par les Noirs, Saint-Louis a pu ainsi préserver son identité africaine. Au temps de Faidherbe il était interdit aux griots d’y passer la nuit, mais nul n’a jamais réussi à briser la chaine des généalogies dont ils assuraient la survie. On y a organisé des autodafés de gris-gris, pourchassé les marabouts et fermé leurs écoles, mais on n’a pas pu y empêcher la construction d’une mosquée «en dur» dès le milieu du XIXe siècle. C’était une gageure : malgré sa modestie c’est à la fois le plus ancien monument de ce type et de cette nature construit dans la sous-région avec ce matériau et le premier financé par souscription publique ! Pendant des générations seule la minorité européenne et métisse avait le droit, à Saint-Louis, de porter l’appellation «d’Habitants», et pourtant il n’y a pas eu de «kriolisation» de la population, c’est-à-dire de constitution d’une oligarchie dominante avec sa langue et ses rites.
A Saint-Louis, au contraire, les «signares» tenaient des «sabars» et les métis se mettaient au wolof. Même si aux élections législatives de 1914, qui allaient faire date, la vieille cité ne donna pas ses voix à Blaise Diagne, sans doute parce que le ressentiment contre Dakar qui lui avait ravi le titre de capitale de l’AOF ne s’était pas dissipé, c’est de l’île que partit le mouvement de jeunes patriotes, formés pourtant, pour la plupart, à l’école coloniale, qui allaient contribuer à faire du Goréen le premier député noir du Sénégal ! Ce sont donc les saint-louisiens qui ont assimilé le colonisateur et non l’inverse et c’est une prouesse que leur cité, porte drapeau de la présence française en Afrique de l’ouest, soit devenue le symbole de la plus médiatique des valeurs sénégalaises : la «téranga» !
Alors, pourquoi, avec tant d’atouts, ne peut-on se permettre de démomifier Saint-Louis ? Pourquoi cette ville ne cesserait-elle pas de toujours donner l’impression d’être une cité recroquevillée dans son passé, frileuse, toute confinée dans une histoire qui, quelquefois la concerne si peu ? Pourquoi ne se muerait-elle pas en une cité conquérante et ne ferait-elle pas plus de place à l’héritage vivant de ceux qui lui ont donné leur sang et leur sueur plutôt qu’au souvenir d’un passé à jamais enfoui ? Pourquoi, pour tout dire, ne pas enterrer Saint-Louis, qui est le nom de plusieurs dizaines de villes dans le monde, et redonner vie à Ndar, nom qui appartient à notre patrimoine et qui a une histoire ?
Oui, nous pouvons déboulonner la statue du général Faidherbe sans que le ciel nous tombe sur la tête, nous pouvons débaptiser la place et le pont qui portent son nom, et qui ne sont pas ses créations, sans attenter à l’histoire et surtout à l’Histoire !
Et puis sachons raison garder : le Saint-Louis hérité de la colonisation française n’est ni la Carthagène des Indes ni la Quito d’Equateur héritées de l’occupation espagnole (7). A l’exception du pont métallique (8) il n’y a pas sur l’île de monument qui mérite d’être inscrit à l’inventaire du patrimoine national au point d’être totalement intouchable. Je ne veux pas dire par là qu’on peut mettre à bas tous ses vieux édifices, je veux seulement dire que nous devons reconnaître que, l’âge, le climat, les déboires économiques aidant, plus aucun d’entre eux ne constitue aujourd’hui un modèle achevé et intact des constructions à argamasse de la période faste.
L’important, aujourd’hui, c’est de redonner à la vieille cité l’harmonie et la grâce dont avaient peut-être rêvé les plus inspirés de ses bâtisseurs ainsi que cette patine qui est la marque d’une longue existence, de restituer la divine surprise qu’ont dû éprouver ceux qui descendaient le fleuve et venaient d’un monde où dominent la paille et l’argile, et qui au détour d’une courbe, ont vu la ville de Saint-Louis surgir au-dessus de l’eau. Il faut restituer Saint-Louis à l’histoire et rendre à Ndar ce qui lui appartient et qui non seulement survivra au pic des démolisseurs, mais pourrait encore remplir une enviable corbeille de mariage ou inspirer un risorgimento salvateur. Ce qui appartient à Ndar c’est ce site improbable et aujourd’hui menacé, entre mer et rivières, avec vue imprenable sur l’infini, avec, sur plusieurs kilomètres, le fleuve Sénégal qui frôle la côte sans se décider à rejoindre l’Atlantique, faisant sa coquette comme le paon fait la roue.
Mais la perfide mer se vengera de ces simagrées en plantant une infranchissable «barre» à son embouchure. Ce qui appartient à Ndar c’est aussi cette mince et étroite pellicule de sable et d’argile, à la jonction du désert et de la mangrove, conquise sur les marées et la vase, longtemps hérissée de bâtisses blanches et carrées qui lui donnaient l’air d’une cité méditerranéenne exilée sous les tropiques. Ce qui appartient à Ndar c’est cette douceur de vivre qui y ramène les retraités et qui y retient les femmes : nulle part au Sénégal celles -ci ne sont aussi sûres d’elles-mêmes, et nulle part les mères ne sont autant aimées. C’est cette civilité qui est probablement le fruit du modus vivendi imposé par la rencontre d’hommes et de femmes d’origine sociale et ethnique aussi diverse. Ce qui appartient à Ndar c’est, enfin, cette nostalgie dont elle aura toujours à revendre…
(1) Comité d’Action pour la Rénovation de Saint-Louis
(2) Probablement l’une des plus tenaces supercheries de l’histoire coloniale du Sénégal, que Senghor a contribué à répandre. Il ne s’agissait en fait que du manifeste d’un négociant qui revendiquait une plus grande liberté de commerce et nullement l’émancipation des esclaves.
(3) Il s’agissait du Bulletin de la Chambre de Commerce.
(4) Qui, même en France, se souvient du Baron Hyde de Neuville dont le nom avait été donné à la principale artère du sud de l’île et qui ne devait ce privilège qu’au fait qu’il était Ministre de la Marine, donc chargé des colonies ?
(5) Comme la rue Navarin, toujours au sud, nom d’une modeste victoire navale française sur les Turcs (1827) qui eut lieu au moment même où l’on baptisait pour la première fois des rues à Saint-Louis.
(6) A titre d’exemples : en 1857 Faidherbe fait bombarder tous les villages du Fouta situés au bord du fleuve Sénégal, de Nguidjilogne à Dembancané, soit sur 150 km ; en mars 1861 il fait incendier 25 villages du Cayor, entre Kelle et Mekhé etc.
(7) En 1838 il y avait à Saint-Louis 310 maisons de briques, de qualité très inégale, et 3000 cases dont 2/3 en paille ; en 1870 la ville comptait 500 maisons en briques et encore 4000 cases !
(8) Rappelons tout de même que le pont d’origine a été remplacé, il y a quelques années, par un pont neuf construit à l’identique.
NB : La mention indiquant que le pont Faidherbe a été reconstruit n’était évidemment pas dans le texte d’origine, publié il y a plus de 25 ans dans Nouvel Horizon. De même que l’explication du sigle Carsal.










 ACCUEIL
ACCUEIL