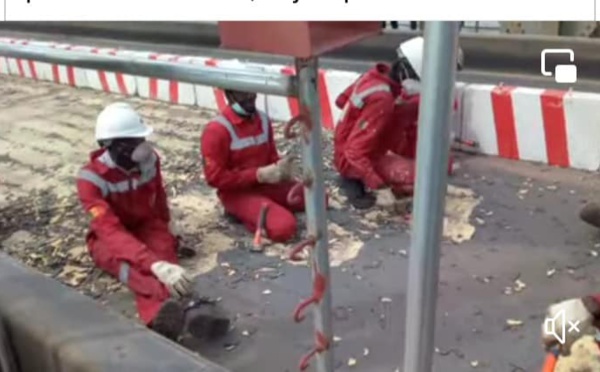Si le projet d’Acte III de la décentralisation est unanimement approuvé, il n’en demeure pas moins que ses propositions en termes de redécoupage de certaines unités territoriales sont loin de rencontrer les attentes des populations concernées. Les réaménagements proposés ont été immédiatement rejetés et les analystes parlent d’un manque de communication, mais aussi d’une faible maîtrise des paramètres en jeu, les héritages pré-étatiques et les rapports aux territoires en particulier.
Ainsi, nous avons voulu - et sans aucune intention de remettre en cause le travail déjà très remarquable de la commission « Cohérence territoriale » - saisir l’occasion pour apporter notre modeste contribution à la connaissance des réalités profondes que recouvre la notion de territoire, notamment en termes de rapports homme/territoire. Les rapports des populations à leurs territoires - rapports qui ne se pas limitent aux seuls usages - constituent en effet une donnée fondamentale qu’il faut nécessairement prendre en compte pour réussir pleinement - et en toute sérénité - un projet aussi ambitieux que celui relatif à l’Acte III de la décentralisation au Sénégal.
Le territoire : une identité
Tel que définit dans le vocabulaire scientifique, et géographique en particulier, le territoire désigne toute portion de l’espace terrestre appropriée (humanisée) et destinée à satisfaire les besoins du groupe occupant, notamment en termes d’habitat, d’activités, de réseaux divers, etc. Il est le produit d’une conquête ; le support d’une identité. Il s’identifie par son nom, sa localisation, son étendue et ses limites. Sa forme et sa structure ont un sens. Elles peuvent en effet être révélatrices des compromis et des rapports de forces qui sont à l’origine de sa formation. Dans les sociétés traditionnelles africaines, l’acte de mise en valeur initiale - par le feu (droit de feu) ou par le défrichement (droit de hache) - en constitue - à l’échelon micro-local - le moment fondateur et garantit au groupe occupant tous les droits. C’est ce qu’on appelle le Lamanat en droit coutumier sénégalais (Wolof). Les Lamanes, c’est-à-dire les chefs de terres, - tout comme les buur (roi) - ont jusqu’à la colonisation, occupé une place très importante dans l’administration des royaumes et leurs descendants jouissent encore d’une forte notoriété au niveau de leur territoires respectifs. Ces droits peuvent être également acquis par domination - c’est-à-dire par soumission du groupe occupant par un autre plus fort -, mais les territoires qui en découlent sont souvent instables et peu propices au développement et à l’épanouissement durables d’une identité.
Chez certaines communautés, le territoire a un caractère sacré et entretient avec le groupe occupant un lien presque consubstantiel. L’histoire de sa découverte est souvent émaillée de mythes et de légendes qui tendent à en faire un don céleste. Des parallèles avec des lieux universellement reconnus saints sont systématiquement établis dans le but d’authentifier sa sacralité, mais également de forcer le respect et l’admiration des communautés environnantes.
Les territoires du Sénégal : des origines et des réalités complexes
Les territoires trouvés par les colons à leur arrivée n’étaient pas de simples étendues de terres primitives, sans organisation. Bref, des no man’s land. Les peuples qui les occupaient - c’est-à-dire nos grands-parents et nos arrière-grands-parents - disposaient déjà de formes territoriales très avancées, bien organisées et parfaitement hiérarchisées. Dans une certaine mesure, l’administration coloniale n’a fait que conserver les formes précoloniales, les manœuvres territoriales les plus importantes ayant eu lieu dans les régions nomades (Mali, Niger, Mauritanie). Une observation attentive des découpages successifs permet en effet de constater de curieuses coïncidences entre des limites de royaumes et celles des certains découpages postérieurs (cantons, arrondissements, régions, etc.). C’est également dans la logique de maintenir ces formes que le pouvoir colonial avait opté de confier l’administration des cantons et autres subdivisions territoriales locales aux chefferies indigènes. C’est le régime de l’indigénat. En optant pour ce système de gouvernance, l’administration coloniale visait deux objectifs : la préservation des équilibres et rapports de forces existants et la facilitation de l’exploitation des ressources de la colonie par chefs locaux interposés. L’option de la force pour dominer et s’installer librement ne semble pas préméditée. Elle s’est dessinée au fur et à mesure des circonstances et n’avait aucunement pour objectif de faire table-rase sur l’existant.
Au Sénégal, les territoires actuels sont une émanation directe de ces formes territoriales historiques (royaumes, provinces, cercles, cantons …). Autrement dit, leurs palimpsestes. Aujourd’hui, celles-ci ont - dans leur forme juridique - certes disparu, mais leurs empreintes restent indélébilement gravées dans la mémoire locale. Une visite dans les anciennes provinces du Baol, du Cayor ou du Sine, par exemple, permettrait de constater que certains notables locaux sont encore capables de reconstituer avec précision les limites de leur territoire d’origine dont l’identité est encore jalousement entretenue par les descendants des lignages fondateurs. L’attachement au territoire d’origine s’exprime par l’usage continu de titres historiques (buur,djiaraf, lamane, farba, etc.) pour désigner certaine chefs locaux ou de noms autochtones pour indiquer le territoire de résidence.
Le titre de buur, par exemple, semble subsister dans certaines contrées du Sénégal. Le buur y est encore une institution reconnue, respectée, vénérée, consultée, et surtout crainte. Le burr est le gardien des symboles de la royauté, le protecteur du legs des ancêtres. A Gandiaye « buur Gandiaye » ou à Oussouye « Roi de Oussouye » - pour ne citer que ces deux exemples - le titre de buur n’est pas seulement honorifique. L’autorité des buur demeure une réalité et s’appuie sur un territoire bien défini, celui des ancêtres. Ils restent encore investis d’un certain nombre de missions parmi lesquelles la préservation de l’unité physique du territoire d’origine et le maintien de la paix sociale occupent une place extrêmement importante. Ils sont régulièrement consultés et intercèdent souvent en faveur de personnes résidants dans leur territoire.
Dans d’autres contextes, la référence au droit musulman - et parfois coutumier - continue de légitimer l’exercice des droits pré-étatiques. A Touba,Tivaoune, Darou Mosty, Médina Gounass ou Cambérène à Dakar, les Khalifs jouent un rôle extrêmement important dans la gestion des affaires de leurs cités qui - comme l’a déjà, surtout pour le cas de Touba, montré le Géographe sénégalais Cheikh Guèye - constituent les signes de processus de territorialisation réussi ; les marques d’un attachement fusionnel au territoire originel. Ils sont les dépositaires des pouvoirs des Khalifs fondateurs et s’arrogent une autorité « illimitée » sur leurs territoires respectifs.
A Touba, le titre foncier obtenu de l’administration coloniale garantit à la cité une exterritorialité de fait - immunité territoriale - et constitue le principal outil de légitimation des extensions successives que connait le territoire de la ville depuis plus d’une trentaine d’années. La Grande Mosquée joue une fonction territoriale éminemment importante et symbolise l’unité du territoire dans lequel elle s’inscrit. Comme le souligne bien Paul Pelissier (1966), Géographe colonial, « la construction de la Mosquée de Touba a contribué puissamment d’une part, à donner au Mouridisme une structure centralisée, d’autre part à lui fixer un centre de gravité stable dont l’existence est largement responsable de la sédentarisation du domaine d’action du Khalif général donnant désormais à la confrérie des assises spatiales définitives et lui insuffle un véritable patriotisme géographique ». La demande, en 1984, de rattachement de la Communauté rurale de Kéré Mbaye à celle de Touba n’est pas anodine. En effet, elle fait partie - comme les daara périphériques - des différents stratagèmes développés par l’autorité khalifale pour remobiliser et sécuriser - à travers un Grand Touba pour reprendre le terme de Cheikh Guèye (1999) - l’« espace vital » de la Communauté. Par rapport à ce décret, Jaques Mariel Nzouankeu (1985) note que « les populations des deux communautés rurales sont unies par de multiples liens historiques, culturels et économique et qu’en réalité « Kéré Mbaye » se présente comme une communauté rurale satellite de celle de Touba ». Egalement, le rattachement en 2001 de la Sous-préfecture de Taïf à celle de Ndame obéit à la même logique. Il faut dire qu’au delà de sa dimension stratégique et géopolitique, le système d’administration territoriale adopté par le Cheikh Ahmadou Bamba pourrait bien inspirer notre système de gouvernance territoriale actuel. La plupart des chercheurs qui se sont intéressés au Mouridisme ont en effet fortement - et sans fausse modestie - loué son originalité, et surtout sa souplesse et son efficacité.
Ailleurs en Afrique, les territoires historiques continuent d’alimenter des souvenirs et d’apparaître en filigrane des territoires actuels. Les velléités séparatistes constatées dans certains pays d’Afrique ne sont rien d’autre qu’une forme de résurgence de ces identités territoriales historiques ou autochtones. Partout où l’Etat a failli a ses missions, et à son devoir d’équité territoriale plus particulièrement, le séparatisme et la rébellion se sont érigées en réponses et peuvent, dans les cas extrêmes, remettre en cause l’intégrité territoriale de tout un Etat.
La communauté rurale : une maille à manier avec précaution !
La Communauté rurale n’est pas seulement une vulgaire juxtaposition de terroirs villageois. Ses habitants forment aussi une communauté et entretiennent entre eux des liens d’origine, d’intérêts, de pratiques et même de croyances. Elle est une identité et constitue, de ce point de vue, la maille territoriale la complexe, la plus sensible.
En réalité, la création de la communauté rurale entre en droite ligne des stratégies mises en œuvre depuis l’indépendance pour neutraliser les chefferies locales. En créant effet cet échelon, le pouvoir central espérait diviser davantage les communautés et éliminer définitivement les chefferies qui les noyautaient. Il pensait également renforcer sa présence au niveau local et régler définitivement le statut de la terre ; statut que la loi de 1964 sur le domaine national n’a pas permis de clarifier suffisamment. Mais la réalité est tout autre. Au contraire, la création des communautés rurales a eu pour effets la fortification des centralités des localités coutumières et maraboutiques devenues pour la plupart chef-lieu de communauté rurale et le renforcement des pouvoirs de leurs chefs qui, au fil du temps, ont systématiquement pris en otage les instruments de décision légaux, le conseil rural surtout. C’est ce qu’on appelle « effet chef-lieu ». Nombre de conseils ruraux sont encore dominés par leurs représentants et certaines de leurs délibérations, plus particulièrement celles touchant au foncier, sont systématiquement soumises à leurs appréciations. Même si, par courtoisie pour les uns et par méfiance pour les autres, ces chefs nuancent ou refusent généralement leur casquette de contre-pouvoirs, ils demeurent encore très emblématiques de la persistance de la chefferie traditionnelle.
Dans certaines communautés rurales, l’Etat et ses ramifications n’y sont en réalité tolérés qu’à travers leurs manifestations habituelles (fonctionnariat local, collecte de la taxe rurale, élections, cérémonies officielles, etc.). Pour le reste, la vie communautaire s’organise autour des chefferies locales dont la prééminence sur les autorités légales (chef de villages, conseil rural, …) est incontestable. Le statut officiel de Communauté rurale ne sert en fait que selon les circonstances et n’est souvent brandi que pour légitimer le droit, comme toute autre Communauté rurale, à un bien ou un privilège public (équipement, aides, fournitures diverses, etc.). La communauté rurale est en réalité le dernier échelon d’une architecture territoriale en « poupée russe » dans laquelle les rapports fonctionnels et hiérarchiques entre les parties constituantes sont quasi-inexistants.
Les pouvoirs de proximité constituent, en Afrique noire, un réel enjeu de gouvernance et requièrent une attention particulière dans la conception et la mise en œuvre des projets de territoires. Seuls quelques rares pays (l’Afrique du Sud, le Togo, la RDC) sont parvenus à les gérer de manière plus ou moins courageuse, notamment en reconnaissant leur légitimité, mais aussi en légiférant sur les modalités de leur participation à la gestion des affaires publiques et locales.
Ainsi, la grande question est la suivante : comment, dans un contexte pareil, arriver aux résultats souhaités tout en préservant, les liens, les identités et les héritages pré-étatiques ? Bref, les intérêts supposés « inaliénables » des groupes ?
L’information et la concertation : des préalables incontournables
A notre avis, l’information, la concertation et le compromis constituent les seules approches susceptibles de nous mener vers les résultats visés. Ils doivent être, comme par le passé, érigés en préalables incontournables. Les populations et leurs représentants, - qu’ils soient d’obédience temporelle, spirituelle ou coutumière - doivent être nécessairement consultés concernant tout projet relatif à leur territoire, surtout lorsque celui-ci doit toucher à sa structure. Le découpage territorial du pays est certes truffé d’incohérences qu’il faut absolument corriger pour arriver à des cadres territoriaux plus fonctionnels et économiquement viables, mais les approches adoptées pour produire les améliorations souhaitées doivent être englobantes et fortement inclusives afin de maximiser les chances de succès et de sécuriser les décisions. Le Sénégal n’est pas une exception en ce sens. Bien au contraire. Ici comme dans la majorité des pays d’Afrique colonisés, le pouvoir central reste encore pris en tenaille entre la volonté d’exercer pleinement son autorité - et en toute impartialité - et la crainte de fâcher les « dieux » du passés, les chefferies en particulier. Les formes territoriales héritées de la colonisation étant - dans leur fonctionnement interne - inachevées et mal préparées à leur statut postcolonial. Autrement dit, hybrides.
Alors, ne nous précipitons pas ; prenons le temps d’analyser suffisamment le fond afin de mieux travailler les formes.
Car, comme disait l’autre, « une société ne fonctionne pas en dehors de la réalité dans laquelle elle vit »
Dr Ousmane THIAM
Géographe/Spécialiste en développement territorial
ousmane_thiam2000@yahoo.fr
Ainsi, nous avons voulu - et sans aucune intention de remettre en cause le travail déjà très remarquable de la commission « Cohérence territoriale » - saisir l’occasion pour apporter notre modeste contribution à la connaissance des réalités profondes que recouvre la notion de territoire, notamment en termes de rapports homme/territoire. Les rapports des populations à leurs territoires - rapports qui ne se pas limitent aux seuls usages - constituent en effet une donnée fondamentale qu’il faut nécessairement prendre en compte pour réussir pleinement - et en toute sérénité - un projet aussi ambitieux que celui relatif à l’Acte III de la décentralisation au Sénégal.
Le territoire : une identité
Tel que définit dans le vocabulaire scientifique, et géographique en particulier, le territoire désigne toute portion de l’espace terrestre appropriée (humanisée) et destinée à satisfaire les besoins du groupe occupant, notamment en termes d’habitat, d’activités, de réseaux divers, etc. Il est le produit d’une conquête ; le support d’une identité. Il s’identifie par son nom, sa localisation, son étendue et ses limites. Sa forme et sa structure ont un sens. Elles peuvent en effet être révélatrices des compromis et des rapports de forces qui sont à l’origine de sa formation. Dans les sociétés traditionnelles africaines, l’acte de mise en valeur initiale - par le feu (droit de feu) ou par le défrichement (droit de hache) - en constitue - à l’échelon micro-local - le moment fondateur et garantit au groupe occupant tous les droits. C’est ce qu’on appelle le Lamanat en droit coutumier sénégalais (Wolof). Les Lamanes, c’est-à-dire les chefs de terres, - tout comme les buur (roi) - ont jusqu’à la colonisation, occupé une place très importante dans l’administration des royaumes et leurs descendants jouissent encore d’une forte notoriété au niveau de leur territoires respectifs. Ces droits peuvent être également acquis par domination - c’est-à-dire par soumission du groupe occupant par un autre plus fort -, mais les territoires qui en découlent sont souvent instables et peu propices au développement et à l’épanouissement durables d’une identité.
Chez certaines communautés, le territoire a un caractère sacré et entretient avec le groupe occupant un lien presque consubstantiel. L’histoire de sa découverte est souvent émaillée de mythes et de légendes qui tendent à en faire un don céleste. Des parallèles avec des lieux universellement reconnus saints sont systématiquement établis dans le but d’authentifier sa sacralité, mais également de forcer le respect et l’admiration des communautés environnantes.
Les territoires du Sénégal : des origines et des réalités complexes
Les territoires trouvés par les colons à leur arrivée n’étaient pas de simples étendues de terres primitives, sans organisation. Bref, des no man’s land. Les peuples qui les occupaient - c’est-à-dire nos grands-parents et nos arrière-grands-parents - disposaient déjà de formes territoriales très avancées, bien organisées et parfaitement hiérarchisées. Dans une certaine mesure, l’administration coloniale n’a fait que conserver les formes précoloniales, les manœuvres territoriales les plus importantes ayant eu lieu dans les régions nomades (Mali, Niger, Mauritanie). Une observation attentive des découpages successifs permet en effet de constater de curieuses coïncidences entre des limites de royaumes et celles des certains découpages postérieurs (cantons, arrondissements, régions, etc.). C’est également dans la logique de maintenir ces formes que le pouvoir colonial avait opté de confier l’administration des cantons et autres subdivisions territoriales locales aux chefferies indigènes. C’est le régime de l’indigénat. En optant pour ce système de gouvernance, l’administration coloniale visait deux objectifs : la préservation des équilibres et rapports de forces existants et la facilitation de l’exploitation des ressources de la colonie par chefs locaux interposés. L’option de la force pour dominer et s’installer librement ne semble pas préméditée. Elle s’est dessinée au fur et à mesure des circonstances et n’avait aucunement pour objectif de faire table-rase sur l’existant.
Au Sénégal, les territoires actuels sont une émanation directe de ces formes territoriales historiques (royaumes, provinces, cercles, cantons …). Autrement dit, leurs palimpsestes. Aujourd’hui, celles-ci ont - dans leur forme juridique - certes disparu, mais leurs empreintes restent indélébilement gravées dans la mémoire locale. Une visite dans les anciennes provinces du Baol, du Cayor ou du Sine, par exemple, permettrait de constater que certains notables locaux sont encore capables de reconstituer avec précision les limites de leur territoire d’origine dont l’identité est encore jalousement entretenue par les descendants des lignages fondateurs. L’attachement au territoire d’origine s’exprime par l’usage continu de titres historiques (buur,djiaraf, lamane, farba, etc.) pour désigner certaine chefs locaux ou de noms autochtones pour indiquer le territoire de résidence.
Le titre de buur, par exemple, semble subsister dans certaines contrées du Sénégal. Le buur y est encore une institution reconnue, respectée, vénérée, consultée, et surtout crainte. Le burr est le gardien des symboles de la royauté, le protecteur du legs des ancêtres. A Gandiaye « buur Gandiaye » ou à Oussouye « Roi de Oussouye » - pour ne citer que ces deux exemples - le titre de buur n’est pas seulement honorifique. L’autorité des buur demeure une réalité et s’appuie sur un territoire bien défini, celui des ancêtres. Ils restent encore investis d’un certain nombre de missions parmi lesquelles la préservation de l’unité physique du territoire d’origine et le maintien de la paix sociale occupent une place extrêmement importante. Ils sont régulièrement consultés et intercèdent souvent en faveur de personnes résidants dans leur territoire.
Dans d’autres contextes, la référence au droit musulman - et parfois coutumier - continue de légitimer l’exercice des droits pré-étatiques. A Touba,Tivaoune, Darou Mosty, Médina Gounass ou Cambérène à Dakar, les Khalifs jouent un rôle extrêmement important dans la gestion des affaires de leurs cités qui - comme l’a déjà, surtout pour le cas de Touba, montré le Géographe sénégalais Cheikh Guèye - constituent les signes de processus de territorialisation réussi ; les marques d’un attachement fusionnel au territoire originel. Ils sont les dépositaires des pouvoirs des Khalifs fondateurs et s’arrogent une autorité « illimitée » sur leurs territoires respectifs.
A Touba, le titre foncier obtenu de l’administration coloniale garantit à la cité une exterritorialité de fait - immunité territoriale - et constitue le principal outil de légitimation des extensions successives que connait le territoire de la ville depuis plus d’une trentaine d’années. La Grande Mosquée joue une fonction territoriale éminemment importante et symbolise l’unité du territoire dans lequel elle s’inscrit. Comme le souligne bien Paul Pelissier (1966), Géographe colonial, « la construction de la Mosquée de Touba a contribué puissamment d’une part, à donner au Mouridisme une structure centralisée, d’autre part à lui fixer un centre de gravité stable dont l’existence est largement responsable de la sédentarisation du domaine d’action du Khalif général donnant désormais à la confrérie des assises spatiales définitives et lui insuffle un véritable patriotisme géographique ». La demande, en 1984, de rattachement de la Communauté rurale de Kéré Mbaye à celle de Touba n’est pas anodine. En effet, elle fait partie - comme les daara périphériques - des différents stratagèmes développés par l’autorité khalifale pour remobiliser et sécuriser - à travers un Grand Touba pour reprendre le terme de Cheikh Guèye (1999) - l’« espace vital » de la Communauté. Par rapport à ce décret, Jaques Mariel Nzouankeu (1985) note que « les populations des deux communautés rurales sont unies par de multiples liens historiques, culturels et économique et qu’en réalité « Kéré Mbaye » se présente comme une communauté rurale satellite de celle de Touba ». Egalement, le rattachement en 2001 de la Sous-préfecture de Taïf à celle de Ndame obéit à la même logique. Il faut dire qu’au delà de sa dimension stratégique et géopolitique, le système d’administration territoriale adopté par le Cheikh Ahmadou Bamba pourrait bien inspirer notre système de gouvernance territoriale actuel. La plupart des chercheurs qui se sont intéressés au Mouridisme ont en effet fortement - et sans fausse modestie - loué son originalité, et surtout sa souplesse et son efficacité.
Ailleurs en Afrique, les territoires historiques continuent d’alimenter des souvenirs et d’apparaître en filigrane des territoires actuels. Les velléités séparatistes constatées dans certains pays d’Afrique ne sont rien d’autre qu’une forme de résurgence de ces identités territoriales historiques ou autochtones. Partout où l’Etat a failli a ses missions, et à son devoir d’équité territoriale plus particulièrement, le séparatisme et la rébellion se sont érigées en réponses et peuvent, dans les cas extrêmes, remettre en cause l’intégrité territoriale de tout un Etat.
La communauté rurale : une maille à manier avec précaution !
La Communauté rurale n’est pas seulement une vulgaire juxtaposition de terroirs villageois. Ses habitants forment aussi une communauté et entretiennent entre eux des liens d’origine, d’intérêts, de pratiques et même de croyances. Elle est une identité et constitue, de ce point de vue, la maille territoriale la complexe, la plus sensible.
En réalité, la création de la communauté rurale entre en droite ligne des stratégies mises en œuvre depuis l’indépendance pour neutraliser les chefferies locales. En créant effet cet échelon, le pouvoir central espérait diviser davantage les communautés et éliminer définitivement les chefferies qui les noyautaient. Il pensait également renforcer sa présence au niveau local et régler définitivement le statut de la terre ; statut que la loi de 1964 sur le domaine national n’a pas permis de clarifier suffisamment. Mais la réalité est tout autre. Au contraire, la création des communautés rurales a eu pour effets la fortification des centralités des localités coutumières et maraboutiques devenues pour la plupart chef-lieu de communauté rurale et le renforcement des pouvoirs de leurs chefs qui, au fil du temps, ont systématiquement pris en otage les instruments de décision légaux, le conseil rural surtout. C’est ce qu’on appelle « effet chef-lieu ». Nombre de conseils ruraux sont encore dominés par leurs représentants et certaines de leurs délibérations, plus particulièrement celles touchant au foncier, sont systématiquement soumises à leurs appréciations. Même si, par courtoisie pour les uns et par méfiance pour les autres, ces chefs nuancent ou refusent généralement leur casquette de contre-pouvoirs, ils demeurent encore très emblématiques de la persistance de la chefferie traditionnelle.
Dans certaines communautés rurales, l’Etat et ses ramifications n’y sont en réalité tolérés qu’à travers leurs manifestations habituelles (fonctionnariat local, collecte de la taxe rurale, élections, cérémonies officielles, etc.). Pour le reste, la vie communautaire s’organise autour des chefferies locales dont la prééminence sur les autorités légales (chef de villages, conseil rural, …) est incontestable. Le statut officiel de Communauté rurale ne sert en fait que selon les circonstances et n’est souvent brandi que pour légitimer le droit, comme toute autre Communauté rurale, à un bien ou un privilège public (équipement, aides, fournitures diverses, etc.). La communauté rurale est en réalité le dernier échelon d’une architecture territoriale en « poupée russe » dans laquelle les rapports fonctionnels et hiérarchiques entre les parties constituantes sont quasi-inexistants.
Les pouvoirs de proximité constituent, en Afrique noire, un réel enjeu de gouvernance et requièrent une attention particulière dans la conception et la mise en œuvre des projets de territoires. Seuls quelques rares pays (l’Afrique du Sud, le Togo, la RDC) sont parvenus à les gérer de manière plus ou moins courageuse, notamment en reconnaissant leur légitimité, mais aussi en légiférant sur les modalités de leur participation à la gestion des affaires publiques et locales.
Ainsi, la grande question est la suivante : comment, dans un contexte pareil, arriver aux résultats souhaités tout en préservant, les liens, les identités et les héritages pré-étatiques ? Bref, les intérêts supposés « inaliénables » des groupes ?
L’information et la concertation : des préalables incontournables
A notre avis, l’information, la concertation et le compromis constituent les seules approches susceptibles de nous mener vers les résultats visés. Ils doivent être, comme par le passé, érigés en préalables incontournables. Les populations et leurs représentants, - qu’ils soient d’obédience temporelle, spirituelle ou coutumière - doivent être nécessairement consultés concernant tout projet relatif à leur territoire, surtout lorsque celui-ci doit toucher à sa structure. Le découpage territorial du pays est certes truffé d’incohérences qu’il faut absolument corriger pour arriver à des cadres territoriaux plus fonctionnels et économiquement viables, mais les approches adoptées pour produire les améliorations souhaitées doivent être englobantes et fortement inclusives afin de maximiser les chances de succès et de sécuriser les décisions. Le Sénégal n’est pas une exception en ce sens. Bien au contraire. Ici comme dans la majorité des pays d’Afrique colonisés, le pouvoir central reste encore pris en tenaille entre la volonté d’exercer pleinement son autorité - et en toute impartialité - et la crainte de fâcher les « dieux » du passés, les chefferies en particulier. Les formes territoriales héritées de la colonisation étant - dans leur fonctionnement interne - inachevées et mal préparées à leur statut postcolonial. Autrement dit, hybrides.
Alors, ne nous précipitons pas ; prenons le temps d’analyser suffisamment le fond afin de mieux travailler les formes.
Car, comme disait l’autre, « une société ne fonctionne pas en dehors de la réalité dans laquelle elle vit »
Dr Ousmane THIAM
Géographe/Spécialiste en développement territorial
ousmane_thiam2000@yahoo.fr










 ACCUEIL
ACCUEIL