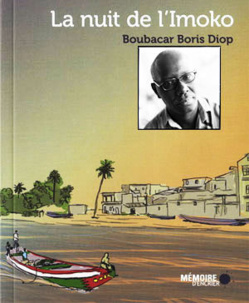
Le recueil de nouvelles ‘’La nuit de l’Imoko’’ (Mémoire d’encrier, mars 2013, 159 pages), dernier ouvrage en date de l’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop est une somme de sept textes qui se tiennent, au sens où ils témoignent de la cohérence d’un auteur dans la délimitation de son univers littéraire et dans le regard qu’il porte sur les gens, les choses.
Boubacar Boris Diop a, depuis ses débuts en 1981, habitué ses lecteurs à une réflexion d’un intellectuel revenu de nombre d’illusions et qui fait montre d’une grande lucidité. Les récits proposés dans ce nouveau livre s’inscrivent, entre portraits, scènes de la vie quotidienne, images et mots, dans cette option de titiller les imaginations.
Tout en suggérant qu’il y a plusieurs réponses, l’écrivain n’est pas dans la position de celui qui pose des questions. Il brouille souvent les pistes, mais il n’en est pas moins clair dans son point de vue. Il est très lucide sur une époque où les valeurs humaines et spirituelles essentielles sont prises au piège d’une quête matérielle dénuée de tout scrupule.
Boubacar Boris Diop est ainsi très critique dans son analyse du rapport d’Abdoulaye Wade avec le pouvoir et sa volonté de s’y accrocher. Sous la plume du romancier, Wade est ‘’ce président qui a tout promis et tout trahi’’. C’est aussi ‘’un autocrate bien plus dangereux qu’on pourrait le croire à première vue''.
L’auteur parle d’un homme qui est ‘’souvent apparu plus comique et fantasque que cruel, estimant que ‘’nous devons garder présent à l’esprit que c’est bien malgré lui qu’il s’est résigné à un système pluraliste et ouvert.’’ Il s’agit ‘’d’un leader de l’opposition ayant eu à son tableau de chasse un vice-président du Conseil constitutionnel’’.
Diop profite de ce récit pour porter un regard critique sur la tendance de ses compatriotes à avoir une lecture simpliste des crises qui secouent le continent. ‘’Peut-être est-il temps que nous apprenions à suspendre notre jugement pour nous donner le temps d’explorer les faits et les dynamiques propres à chaque crise africaine’’, pense-t-il. Cela éviterait, ajoute-t-il, de formuler ‘’des avis péremptoires à partir de clichés dangereusement réducteurs’’.
Dans ‘’La petite vieille’’, Boris Diop se promène dans un pays dont on voit bien que c’est une ancienne colonie française : Malick Cissé y incarne une certaine figure de la résistance à toute forme de diktat extérieur, soupçonne son ami d’enfance Lamine Keita de dénigrer l’Afrique pour plaire à ses bailleurs occidentaux.
Aliéné culturellement et soucieux de son succès personnel, au prix de multiples contorsions et compromissions, Keita, lui, est le symbole de ces élites artistiques dépolitisées, prompts à se cacher derrière leurs créations pour fuir leurs responsabilités vis-à-vis de la société.
Keita, cinéaste, se sent obligé de réécrire des scénarios qui sont conformes à la vision que ses bailleurs se font de l’Afrique, un continent en proie à un chaos entretenu par un ‘’maître’’ qui tire les ficelles. A l’image de Lucie de Braumberg qui ‘’puait l’arrogance’’ et ‘’puait le sentiment de supériorité de celle qui ne doutait pas un instant de se trouver parmi les vaincus’’.
L’emprisonnement de Myriem, accusée de trafic d’enfants, dans un monde qui ‘’serait trop beau s’il n’y avait que des journaux sérieux’’, est, pour Boris Diop, une façon de rapporter les confidences d’un juge sous tutelle, sur les gens du gouvernement et du parti au pouvoir. En somme le système.
‘’Ce sont tous des crapules de la pire espèce ! Quand je pense que le peuple les a librement choisis ! A présent, ils ont l’air de dire à leurs électeurs : Vous vous êtes fait baiser avec ce machin démocratique, tant pis pour vous, essayez d’être moins cons la prochaine fois !’’, dit-il. ‘’C’était un accès de rage pour rien, les hurlements du juge. Des mots et rien d’autre’’.
‘’Retour à Ndar-Géej’’ est à la fois un hymne à Saint-Louis et le chant d’un passé à jamais perdu. Cette nouvelle passe en revue quelques bonnes et mauvaises habitudes bien sénégalaises, partant d’un Saint-Louis colonial, dont il reste les vestiges de maisons à balcons de bois et arcades et les petites rues droites rayonnant à partir de la place principale.
Malick se rend très vite compte qu’il cherchait ‘’une ville introuvable’’. ‘’Une seconde ville, malsaine et chaotique, s’était superposée à celle d’hier, sereine et lumineuse. Le Saint-Louis d’aujourd’hui, c’est la foule compacte et affairée, la fumée noire des pots d’échappement et ce garçon d’une vingtaine d’années qui manque me renverser en pétaradant sur sa moto’’, dit-il.
''Ndar aujourd’hui, ce sont des bruits. Des odeurs très fortes. Une ville aux espaces bouchés. Une ville-souk sur le modèle de la capitale, tristement coincée entre la mer et le fleuve. Hier, la douceur de vivre, aujourd’hui la débrouille vulgaire et bavarde’’.
Dans cette promenade, on évoque ‘’les armes fatales des Saint-Louisiennes – ceintures odorantes de perles, petits pagnes ajourés et encens – destinées à sauver’’ un couple de l’ennui nocturne.
Tàkkusaanu Ndar, Gett Ndar, le quartier des pêcheurs, ‘’seul endroit de la ville qui ait réussi à rester lui-même sans se priver des avantages de la modernité’’, la définition du Doomu Ndar – entre maîtrise d’un parler par habiles sous-entendus et un accent traînant et une gestuelle racée.
A son retour à Ndar, Malick n’a pas reconnu les Dryankés. Aujourd’hui, elles sont ‘’maigres comme un jour sans ceebu suweer, le fameux riz au poisson-fantaisie – spécialité typiquement saint-louisienne -, elles parlent l’anglais commercial avec un drôle d’accent américain’’. ‘’Ne sachant même plus l’art de trainer les pieds pour remplir l’air du parfum de leur gongo, elles s’en vont à grandes enjambées à leur travail. C’est qu’il faut se hâter désormais pour gagner sa vie, puisque cela ne vaut plus rien de la vivre.
‘’Diallo, l’homme sans nom’’ est une plongée dans l’univers de ces ‘’petites gens’’ – les veilleurs et les bonnes – qui, plus souvent, rêvaient de la vie des autres. ‘’Mes patrons semblaient à peine conscients de mon existence’’, dit Diallo qui se cache toujours pour manger.
Diallo, qui avait tué son patron, donne une définition du travail, relevant qu’il ne suffit pas de rester assis sur une natte à l’entrée de la villa et de fixer le vide jusqu’au petit matin. Plus précis, il dit : ‘’Non, être veilleur de nuit, cela veut dire avoir les oreilles aux aguets, le regard perçant et savoir inspirer une vague crainte à chaque passant, savoir lui faire sentir qu’on est là et prêt à tout. Il ne s’agit pas d’aboyer à tort et à travers, comme le font ces stupides chiens de garde que certains prennent, bien à tort, à moins que ce ne soit par pure malveillance, pour nos confrères’’.
Diallo décrit aussi le ‘’monde étrange’’ dans lequel évoluent les bonnes dont certaines n’avaient pas le droit de protester. Il y avait un marché pour elles.
‘’Parfois, rapporte-t-il, arrivait une Libanaise ou une Française. Elle choisissait une bonne après une brève discussion et repartait avec elle dans sa voiture. La jeune fille se mettait aussitôt à cirer le parquet et à faire la cuisine. Certains soirs, les mâles de la maison venaient gémir entre ses cuisses d’un air distrait en rêvant de femmes plus belles et d’aventures plus glorieuses.’’
Les luttes de pouvoir sont au cœur de ‘’La nuit de l’Imoko’’, nouvelle qui donne son titre au recueil. De quoi s’agit-il ? A Djinkoré, tous les sept ans, les Deux Ancêtres se lèvent d’entre les morts et pendant une nuit entière, la nuit de l’Imoko, ils disent à leurs descendants comment ils doivent se comporter pendant les sept années suivantes.
‘’C’est aussi simple que cela’’, sauf que c’est aussi ‘’la nuit où tous les criminels sont confondus, celle aussi où les femmes infidèles, les maris indignes et les chefs injustes sont rappelés à l’ordre par la voix courroucée des Deux Ancêtres’’.
Ce recueil de nouvelles est un nouveau témoin de la fidélité de Boubacar Boris Diop à une ligne apparemment simple, mais dont la profondeur est indéniable. On y retrouve les belles formules, le style parfois déroutant de l’auteur, ainsi que les fulgurantes intuitions qui inscrivent des œuvres – portraits, images et scènes de vie quotidienne - dans la durée.
Dans l’immédiat – la culture étant avant tout un rapport au réel – Boris Diop donne à réfléchir. Sur l’expérience démocratique sénégalaise, après deux alternances réussies au sommet de l’Etat, il constate que ‘’l’art de chasser un mauvais président n’a presque plus de secret pour nous’’.
‘’Peut-être nous reste-t-il à apprendre comment choisir le bon président, celui qui saura emporter notre adhésion raisonnée parce que nous aurons vu en lui un homme d’Etat capable de relever les défis de la citoyenneté et du progrès économique et social’’. Tout un engagement.
APS
Boubacar Boris Diop a, depuis ses débuts en 1981, habitué ses lecteurs à une réflexion d’un intellectuel revenu de nombre d’illusions et qui fait montre d’une grande lucidité. Les récits proposés dans ce nouveau livre s’inscrivent, entre portraits, scènes de la vie quotidienne, images et mots, dans cette option de titiller les imaginations.
Tout en suggérant qu’il y a plusieurs réponses, l’écrivain n’est pas dans la position de celui qui pose des questions. Il brouille souvent les pistes, mais il n’en est pas moins clair dans son point de vue. Il est très lucide sur une époque où les valeurs humaines et spirituelles essentielles sont prises au piège d’une quête matérielle dénuée de tout scrupule.
Boubacar Boris Diop est ainsi très critique dans son analyse du rapport d’Abdoulaye Wade avec le pouvoir et sa volonté de s’y accrocher. Sous la plume du romancier, Wade est ‘’ce président qui a tout promis et tout trahi’’. C’est aussi ‘’un autocrate bien plus dangereux qu’on pourrait le croire à première vue''.
L’auteur parle d’un homme qui est ‘’souvent apparu plus comique et fantasque que cruel, estimant que ‘’nous devons garder présent à l’esprit que c’est bien malgré lui qu’il s’est résigné à un système pluraliste et ouvert.’’ Il s’agit ‘’d’un leader de l’opposition ayant eu à son tableau de chasse un vice-président du Conseil constitutionnel’’.
Diop profite de ce récit pour porter un regard critique sur la tendance de ses compatriotes à avoir une lecture simpliste des crises qui secouent le continent. ‘’Peut-être est-il temps que nous apprenions à suspendre notre jugement pour nous donner le temps d’explorer les faits et les dynamiques propres à chaque crise africaine’’, pense-t-il. Cela éviterait, ajoute-t-il, de formuler ‘’des avis péremptoires à partir de clichés dangereusement réducteurs’’.
Dans ‘’La petite vieille’’, Boris Diop se promène dans un pays dont on voit bien que c’est une ancienne colonie française : Malick Cissé y incarne une certaine figure de la résistance à toute forme de diktat extérieur, soupçonne son ami d’enfance Lamine Keita de dénigrer l’Afrique pour plaire à ses bailleurs occidentaux.
Aliéné culturellement et soucieux de son succès personnel, au prix de multiples contorsions et compromissions, Keita, lui, est le symbole de ces élites artistiques dépolitisées, prompts à se cacher derrière leurs créations pour fuir leurs responsabilités vis-à-vis de la société.
Keita, cinéaste, se sent obligé de réécrire des scénarios qui sont conformes à la vision que ses bailleurs se font de l’Afrique, un continent en proie à un chaos entretenu par un ‘’maître’’ qui tire les ficelles. A l’image de Lucie de Braumberg qui ‘’puait l’arrogance’’ et ‘’puait le sentiment de supériorité de celle qui ne doutait pas un instant de se trouver parmi les vaincus’’.
L’emprisonnement de Myriem, accusée de trafic d’enfants, dans un monde qui ‘’serait trop beau s’il n’y avait que des journaux sérieux’’, est, pour Boris Diop, une façon de rapporter les confidences d’un juge sous tutelle, sur les gens du gouvernement et du parti au pouvoir. En somme le système.
‘’Ce sont tous des crapules de la pire espèce ! Quand je pense que le peuple les a librement choisis ! A présent, ils ont l’air de dire à leurs électeurs : Vous vous êtes fait baiser avec ce machin démocratique, tant pis pour vous, essayez d’être moins cons la prochaine fois !’’, dit-il. ‘’C’était un accès de rage pour rien, les hurlements du juge. Des mots et rien d’autre’’.
‘’Retour à Ndar-Géej’’ est à la fois un hymne à Saint-Louis et le chant d’un passé à jamais perdu. Cette nouvelle passe en revue quelques bonnes et mauvaises habitudes bien sénégalaises, partant d’un Saint-Louis colonial, dont il reste les vestiges de maisons à balcons de bois et arcades et les petites rues droites rayonnant à partir de la place principale.
Malick se rend très vite compte qu’il cherchait ‘’une ville introuvable’’. ‘’Une seconde ville, malsaine et chaotique, s’était superposée à celle d’hier, sereine et lumineuse. Le Saint-Louis d’aujourd’hui, c’est la foule compacte et affairée, la fumée noire des pots d’échappement et ce garçon d’une vingtaine d’années qui manque me renverser en pétaradant sur sa moto’’, dit-il.
''Ndar aujourd’hui, ce sont des bruits. Des odeurs très fortes. Une ville aux espaces bouchés. Une ville-souk sur le modèle de la capitale, tristement coincée entre la mer et le fleuve. Hier, la douceur de vivre, aujourd’hui la débrouille vulgaire et bavarde’’.
Dans cette promenade, on évoque ‘’les armes fatales des Saint-Louisiennes – ceintures odorantes de perles, petits pagnes ajourés et encens – destinées à sauver’’ un couple de l’ennui nocturne.
Tàkkusaanu Ndar, Gett Ndar, le quartier des pêcheurs, ‘’seul endroit de la ville qui ait réussi à rester lui-même sans se priver des avantages de la modernité’’, la définition du Doomu Ndar – entre maîtrise d’un parler par habiles sous-entendus et un accent traînant et une gestuelle racée.
A son retour à Ndar, Malick n’a pas reconnu les Dryankés. Aujourd’hui, elles sont ‘’maigres comme un jour sans ceebu suweer, le fameux riz au poisson-fantaisie – spécialité typiquement saint-louisienne -, elles parlent l’anglais commercial avec un drôle d’accent américain’’. ‘’Ne sachant même plus l’art de trainer les pieds pour remplir l’air du parfum de leur gongo, elles s’en vont à grandes enjambées à leur travail. C’est qu’il faut se hâter désormais pour gagner sa vie, puisque cela ne vaut plus rien de la vivre.
‘’Diallo, l’homme sans nom’’ est une plongée dans l’univers de ces ‘’petites gens’’ – les veilleurs et les bonnes – qui, plus souvent, rêvaient de la vie des autres. ‘’Mes patrons semblaient à peine conscients de mon existence’’, dit Diallo qui se cache toujours pour manger.
Diallo, qui avait tué son patron, donne une définition du travail, relevant qu’il ne suffit pas de rester assis sur une natte à l’entrée de la villa et de fixer le vide jusqu’au petit matin. Plus précis, il dit : ‘’Non, être veilleur de nuit, cela veut dire avoir les oreilles aux aguets, le regard perçant et savoir inspirer une vague crainte à chaque passant, savoir lui faire sentir qu’on est là et prêt à tout. Il ne s’agit pas d’aboyer à tort et à travers, comme le font ces stupides chiens de garde que certains prennent, bien à tort, à moins que ce ne soit par pure malveillance, pour nos confrères’’.
Diallo décrit aussi le ‘’monde étrange’’ dans lequel évoluent les bonnes dont certaines n’avaient pas le droit de protester. Il y avait un marché pour elles.
‘’Parfois, rapporte-t-il, arrivait une Libanaise ou une Française. Elle choisissait une bonne après une brève discussion et repartait avec elle dans sa voiture. La jeune fille se mettait aussitôt à cirer le parquet et à faire la cuisine. Certains soirs, les mâles de la maison venaient gémir entre ses cuisses d’un air distrait en rêvant de femmes plus belles et d’aventures plus glorieuses.’’
Les luttes de pouvoir sont au cœur de ‘’La nuit de l’Imoko’’, nouvelle qui donne son titre au recueil. De quoi s’agit-il ? A Djinkoré, tous les sept ans, les Deux Ancêtres se lèvent d’entre les morts et pendant une nuit entière, la nuit de l’Imoko, ils disent à leurs descendants comment ils doivent se comporter pendant les sept années suivantes.
‘’C’est aussi simple que cela’’, sauf que c’est aussi ‘’la nuit où tous les criminels sont confondus, celle aussi où les femmes infidèles, les maris indignes et les chefs injustes sont rappelés à l’ordre par la voix courroucée des Deux Ancêtres’’.
Ce recueil de nouvelles est un nouveau témoin de la fidélité de Boubacar Boris Diop à une ligne apparemment simple, mais dont la profondeur est indéniable. On y retrouve les belles formules, le style parfois déroutant de l’auteur, ainsi que les fulgurantes intuitions qui inscrivent des œuvres – portraits, images et scènes de vie quotidienne - dans la durée.
Dans l’immédiat – la culture étant avant tout un rapport au réel – Boris Diop donne à réfléchir. Sur l’expérience démocratique sénégalaise, après deux alternances réussies au sommet de l’Etat, il constate que ‘’l’art de chasser un mauvais président n’a presque plus de secret pour nous’’.
‘’Peut-être nous reste-t-il à apprendre comment choisir le bon président, celui qui saura emporter notre adhésion raisonnée parce que nous aurons vu en lui un homme d’Etat capable de relever les défis de la citoyenneté et du progrès économique et social’’. Tout un engagement.
APS










 ACCUEIL
ACCUEIL

















